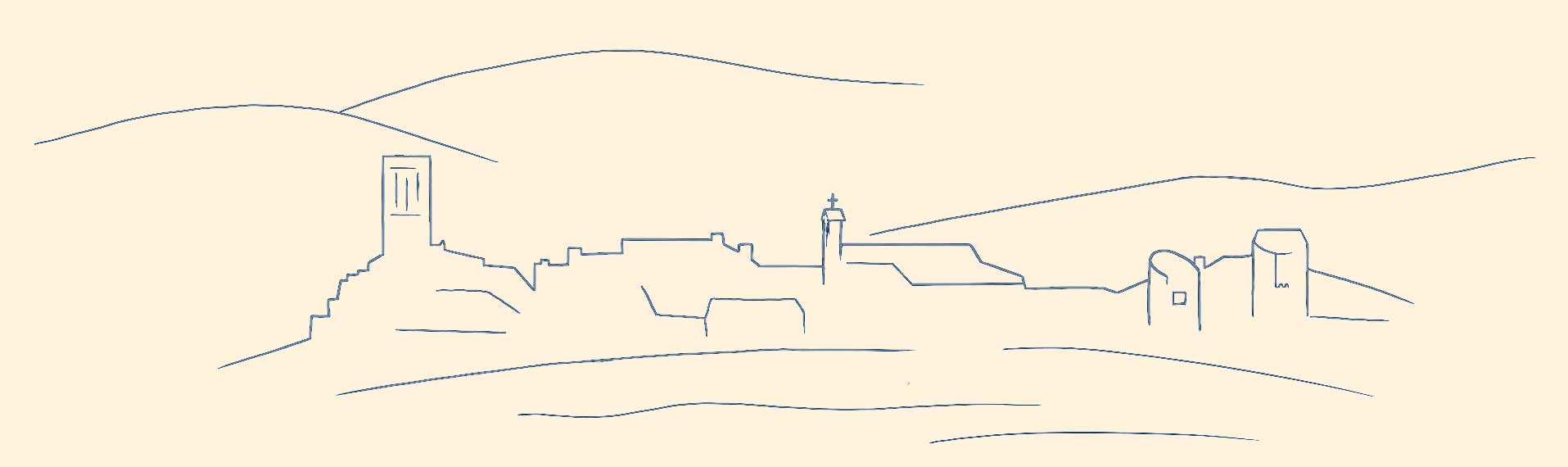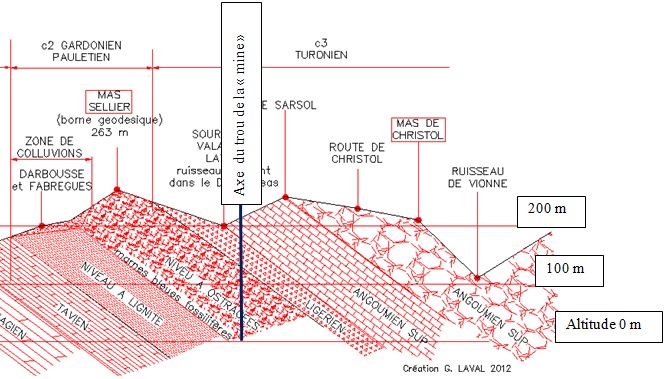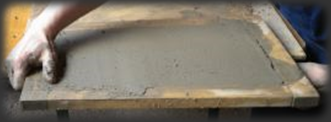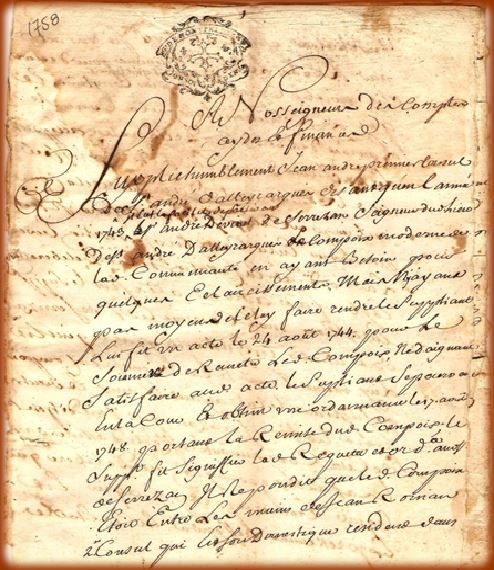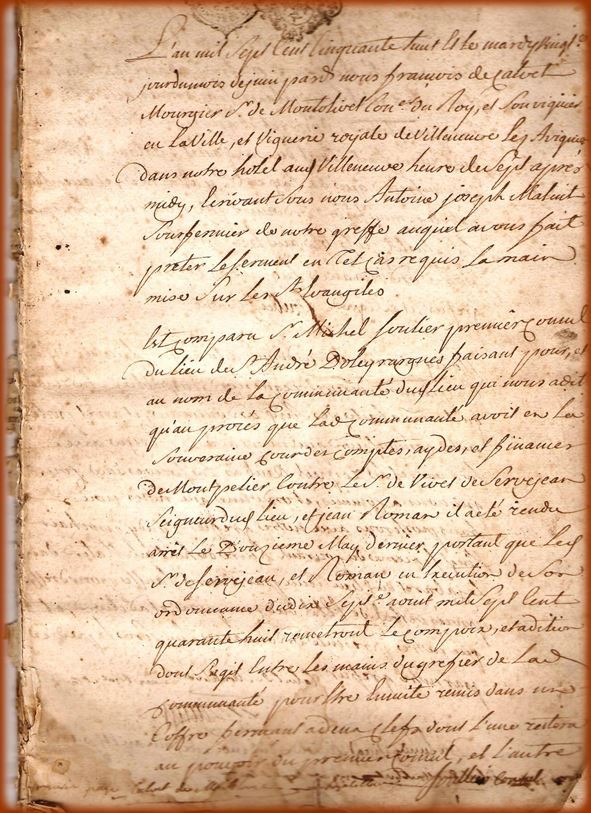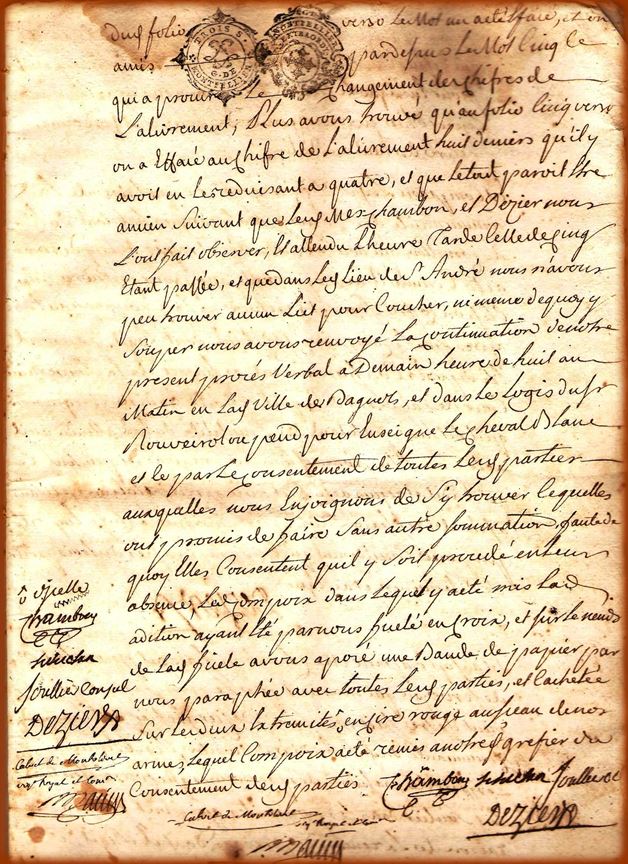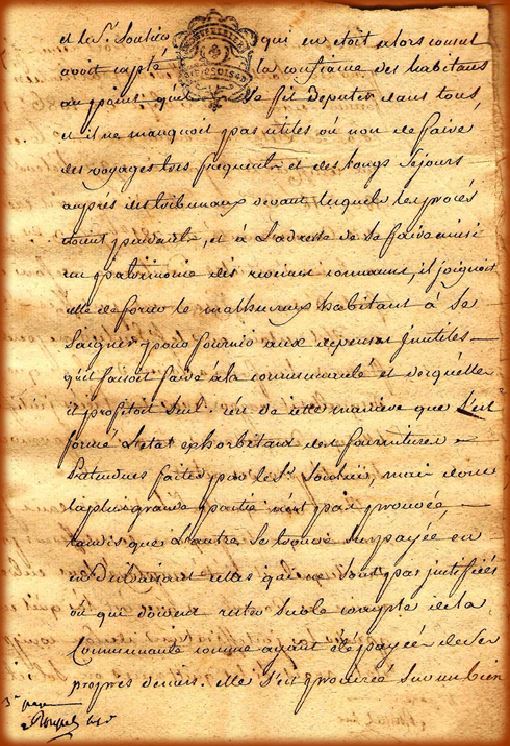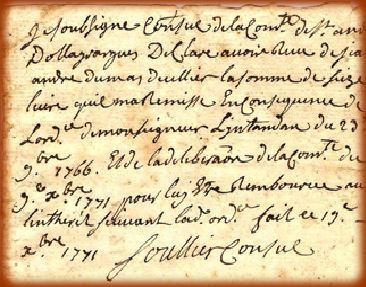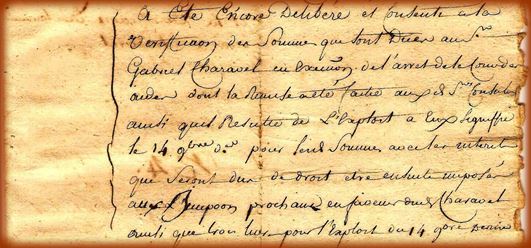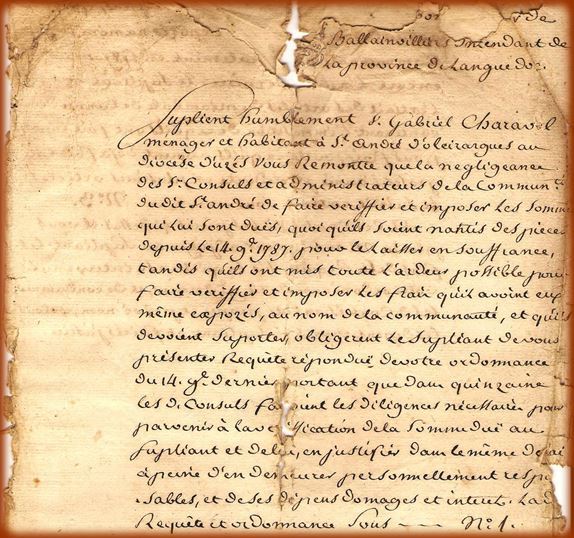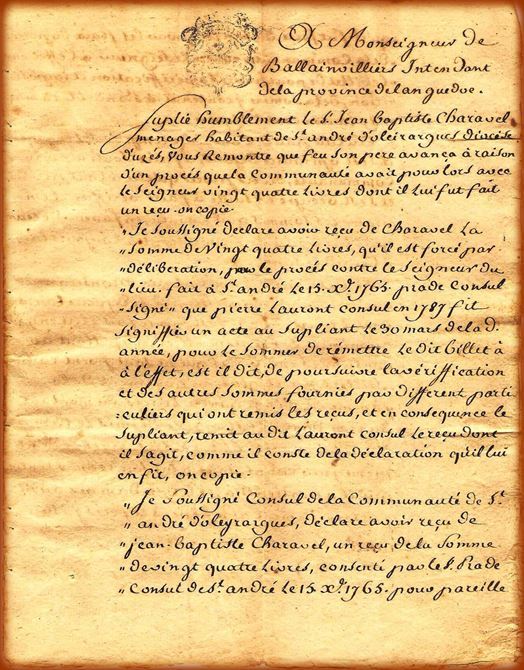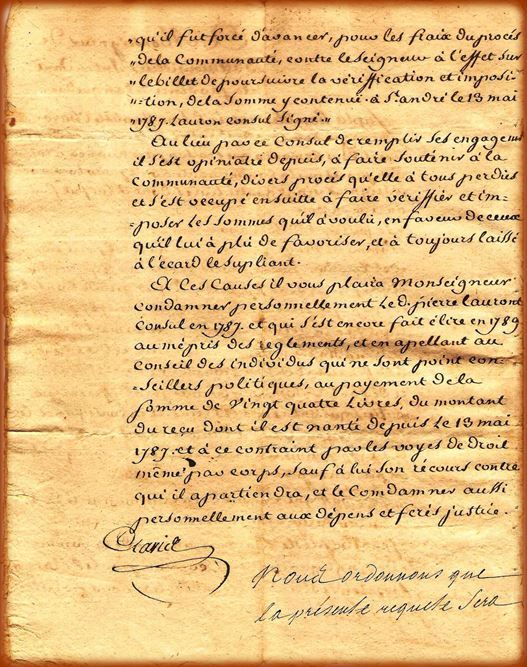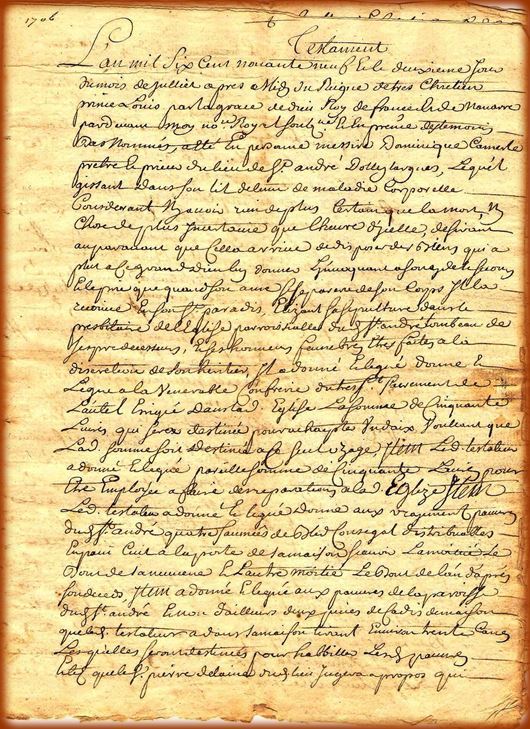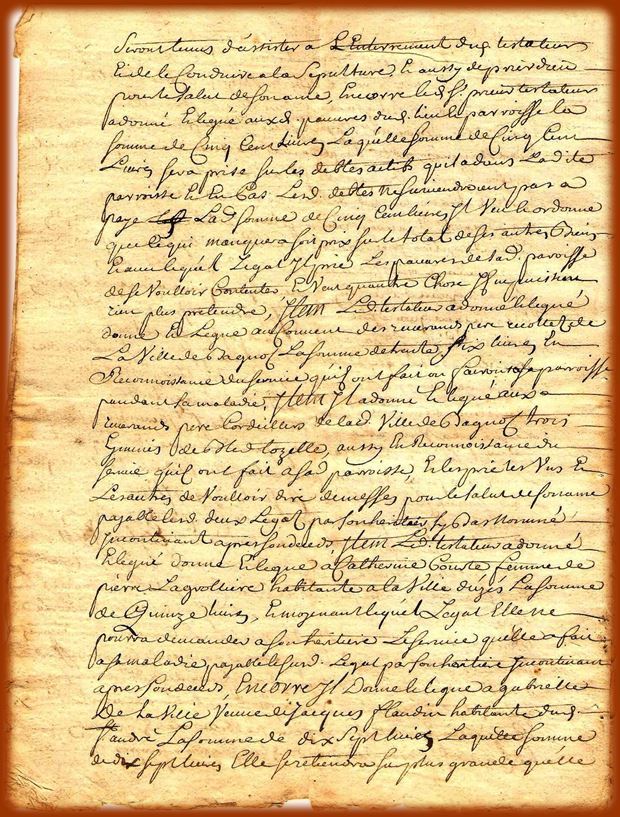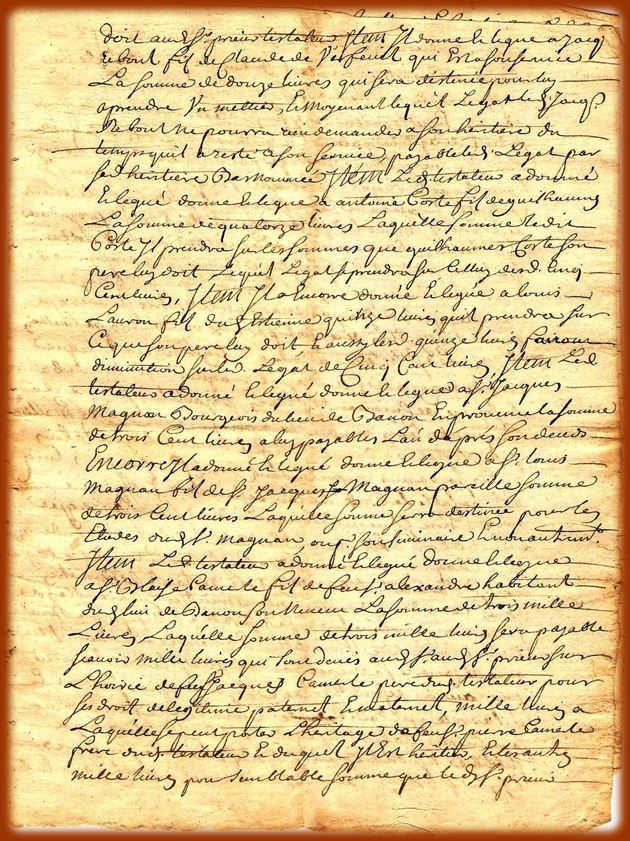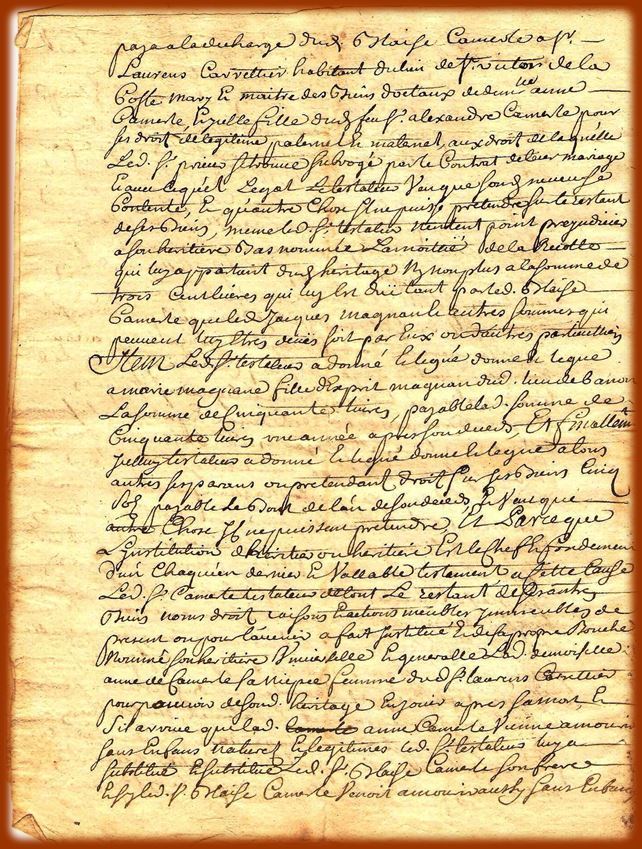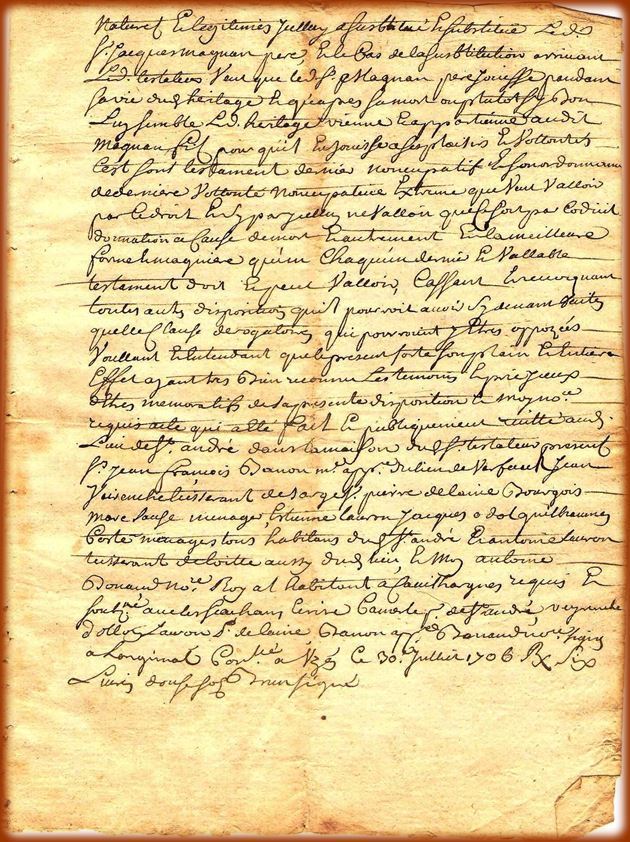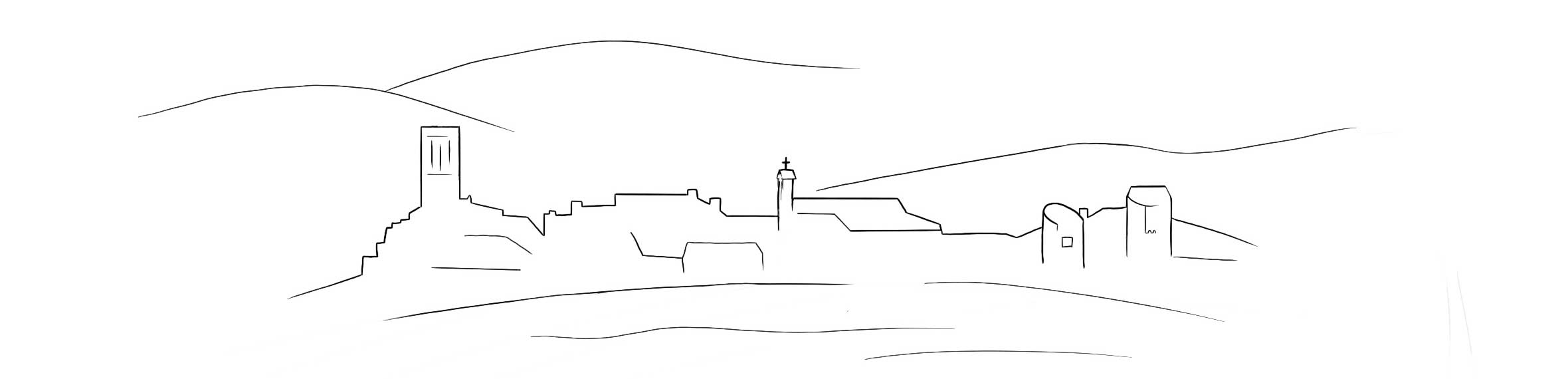IV. I – INTRODUCTION.
L’objectif de ce chapitre est d’éclaircir certaines notions abordées dans les chapitres précédents et de raconter quelques histoires vécues par les habitants pour mieux comprendre leur vie quotidienne au cours des siècles précédents.
Nous y parlerons :
-
- –
Du Calendrier Julien
-
- –
Du calendrier révolutionnaire
-
- –
Des unités de mesures
-
- –
De la valeur des monnaies
-
- –
De la vassalité et du servage
-
- –
De la communauté villageoise
-
- –
Des impôts tels que la taille et la gabelle
-
- –
De la dégradation des forêts et du défrichement
-
- –
De la vie quotidienne et de la mortalité infantile
-
- –
Des us et coutumes, superstition et abus des croyances religieuses
-
- –
De quelques métiers
-
- –
De quelques actes écrits de la vie quotidienne
-
- –
Des mines de lignite
-
- –
De l’histoire de la mine et du chemin oublié
-
- –
Des constructions
-
- –
Des litiges et conflits avec les Seigneurs et entre villageois
-
- –
Du testament de Dominique Camerle prieur de St André d’Olérargues
-
- –
De ce qu’on mangeait dans ces époques lointaines
Vous pouvez cliquer sur le thème pour vous rendre directement au paragraphe concerné.
V.II – LE CALENDRIER JULIEN.
La notion de calendes, nones et ides d’un mois.
Il est surprenant de constater, notamment dans les documents officiels du passé, qu’il est souvent question de calendes de nones et d’ides. Ainsi si je cite le début de la reconnaissance, ci-après, que Guillaume de Gardies fait à l’évêque d’Uzès à propos de Saint André d’Olérargues, il est dit :
« L’An de Notre Seigneur 1292 et le 2 des nones de février, sire Philippe roi de France, sachent tous, que moi Guillaume de Gardies …etc »

Figure 143. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Qu’est-ce que les nones viennent faire dans cette histoire ?
Il faut savoir que jusque vers les années 1680 les dates étaient données en référence à trois moments forts d’un mois du calendrier romain: les « calendes », les « nones » et les « ides ».
Voici ce qu’il en est pour chacune de ces trois notions :
- Les calendes (« Kalendæ » en latin).
Là, c’est la notion la plus simple : c’est tout simplement le premier jour du mois, et ceci pour les douze mois de l’année.
L’expression populaire « renvoyer aux calendes grecques » (« Ad kalendas graecas ») signifie renvoyer indéfiniment, puisque le calendrier grec ne comportait pas de calendes…
Le premier jour du mois était donc « le jour des calendes ». Par exemple : le premier septembre était donc mentionné : « Kalendæ September » (jour des calendes de septembre). Mais, dès le lendemain, donc le deuxième jour du mois, les choses se compliquaient car on faisait déjà référence au deuxième moment fort du mois, « les nones ». - Les nones (« Nonæ » en latin).
On indiquait donc dès le 2ème jour du mois, à combien de jour on était des « nones ». Ainsi le deux septembre était le « a.d. IV Nonas » (4ème jour avant les nones) et le trois septembre le« a.d. III Nonas » (3ème jour avant les nones). Nous pourrions nous attendre à ce que le quatre septembre fût le deuxième jour avant les nones, eh bien : pas du tout !!!… C’était curieusement le « Pridie Nonas » (1er jour avant les nones). On passait en effet directement du troisième au premier jour avant les nones… C’est ainsi ! Déjà Asterix disait : »Ils sont fous ces romains »! Le cinq septembre était le « Nonæ September » (le jour des nones de septembre).
Dès le lendemain des nones, on se référait au troisième moment fort du mois, « les ides ».
- Les ides (« Idus » en latin).
Le six septembre était le « a.d. VIII Idus » (8ème jour avant les ides). Le sept septembre était le « a.d. VII Idus » (7ème jour avant les ides). Puis ça continuait normalement jusqu’au 11 septembre qui était le « a.d. III Idus » (3ème jour avant les ides). Et, tout comme pour les nones, le jour suivant (donc le 12 septembre) n’était pas le 2ème jour avant les ides, mais le « Pridie Idus » (1er jour avant les ides). Ici aussi on passait directement du troisième au premier jour avant les ides… !
Le treize septembre était le « Idus September » (jour des ides de septembre).Dès le lendemain des ides, on se référait au premier moment fort du mois suivant, donc « les calendes » d’octobre.
Le quatorze septembre était le « a.d. XVIII Kaendæ » (18ème jour avant les calendes). Le quinze septembre était le « a.d. XVII Kaendæ » (17ème jour avant les calendes), et ainsi de suite jusqu’au 29 septembre qui était ainsi dénommé : « a.d. III Kaendæ » (3ème jour avant les calendes). Et, tout comme pour les nones et les ides, on sautait une numérotation, et le jour suivant (donc le 30 septembre) était très logiquement le « Pridie Kalendæ » (1er jour avant les calendes).
Ça semble assez simple, sauf qu’à part les calendes (fixées obligatoirement au premier jour d’un mois) les nones et les ides variaient de date selon les mois :
– Les nones
- se produisaient le cinquième jour du mois pour huit mois de l’année(Janvier, février, avril, juin, août, septembre, novembre et décembre) mais le septième jour du mois pour quatre mois de l’année (mars, mai, juillet et octobre).
– Les ides
- se produisaient le treizième jour du mois pour huit mois de l’année (janvier, février, avril, juin, août, septembre, novembre et décembre) mais le quinzième jour du mois pour quatre mois de l’année (mars, mai, juillet et octobre).
– En février
-
- , il y avait une particularité. Comme on voulait éviter de rajouter un mois avec un nombre impair de jours (car les chiffres impairs étaient considérés comme ne plaisant pas aux dieux), on rusait et toutes les quatre années, lorsqu’on rajoutait un jour à février, on n’avait pas comme depuis l’an 1700 environ un « 29 février », mais on procédait de la sorte : on bissait le 24 février, et ce mois avait donc toujours en apparence 28 jours. Voici comment cela était noté :
-
- * 22 février :
-
« a.d. VIII Kaendæ »
-
-
- (8ème jour avant les calendes)
-
- * 23 février :
-
« a.d. VII Kaendæ »
-
-
- (7ème jour avant les calendes) ;
-
- * 24 février :
-
« a.d. VI Kaendæ »
-
-
- (6ème jour avant les calendes) ;
-
- * 25 février :
-
« a.d. bis VI Kaendæ »
-
-
- (6ème jour bis avant les calendes) ;
-
- * 26 février :
-
« a.d. V Kaendæ »
-
-
- (5ème jour avant les calendes);
-
-
- Et ainsi de suite jusqu’au 29 février qui n’existait pas du fait que l’on avait bissé le 24.
-
- C’est l’origine du terme
« bissextile »
-
- …
-
Le sixième jour des calendes de mars de l’an 1581 (en latin : « anno Incarnationis dominicæ MDLXXXI, sexto Kalendas Martii »), c’est à dire le vendredi 24 février 1581, le pape Grégoire XIII a signé, à la villa Mondragone de Frascati (près de Rome, en Italie) la bulle pontificale «Inter Gravissimas ».
Cette bulle visait à réformer le vieux calendrier, dit » julien « , car établi en l’année 708 de la fondation de Rome (ce qui correspond à l’an 45 avant Jésus-Christ pour les historiens, et à l’an 44 av JC pour les astronomes) Jules César lui-même, en vue d’en améliorer la précision astronomique, car une dérive des jours accumulée au fil des siècles était à corriger.
Cette bulle de Grégoire XIII précisait concrètement deux points :
- Il faudrait désormais supprimer le caractère bissextile à trois années séculaires (c’est-à-dire dont le millésime se termine par deux zéros) sur quatre. En pratique si les deux chiffres de gauche du millésime étaient divisibles par quatre (ainsi 1600, 2000 et 2400) l’année séculaire continuerait à être bissextile comme dans le calendrier julien, mais s’ils ne l’étaient pas (ainsi 1700, 1800, 1900 et 2100) l’année n’aurait que 365 jours et non 366 comme dans le calendrier précédent.
- Le deuxième point de la bulle pontificale « Inter Gravissimas » de Grégoire XIII était littéralement révolutionnaire. Il s’agissait de supprimer carrément dix jours dans l’histoire du monde, et de faire suivre le jeudi 4 octobre 1582 du vendredi 15 octobre 1582 !!!… de quoi laisser perplexe bien des laïcs mais aussi bien des clercs … La période fut soigneusement choisie pour tomber en dehors du Carême et de l’Avent! C’est à cause (ou grâce) du pape Grégoire XIII que notre calendrier actuel est dit « calendrier grégorien ».
V.II – LE CALENDRIER REVOLUTIONNAIRE.
A partir de 1792 et jusqu’à 1806 c’est le calendrier révolutionnaire qui est en vigueur.
Voici un exemple :
« Extrait des registres de délibération de la commune de St André Doleyrargues 2° arrondissement du Gard.
Du douzième Fructidor an dix de la République française. Le citoyen maire ayant extraordinairement convoqué le Conseil de la Commune en exécution de la circulaire du préfet du vingt et un thermidor dernier ; (…) »
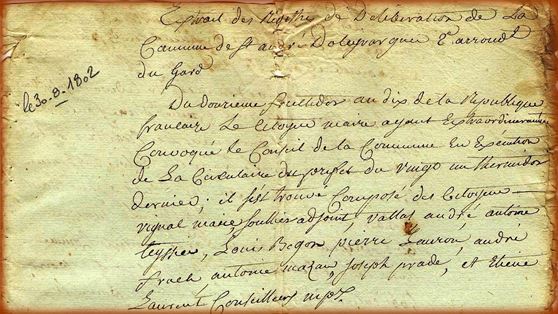
-
-
-
-
-
- *
Figure 144. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Comment ça marche … ? L’année du calendrier républicain était découpée en douze mois de trente jours chacun ( soit 360 jours), plus cinq à six jours (selon les années) ajoutés en fin d’année pour qu’elle reste alignée avec l’année tropique je ne rentrerai pas dans l’explication complexe et fastidieuse qui leur permettait de retomber sur leurs pieds. Mais les noms de mois valent le coup de les rappeler.
-
- aire Vendémiaire
-
- Mois d’automne (terminaison en
-
-
-
-
-
- (22 septembre ~ 21 octobre) – Période des vendanges
-
-
Brumaire
-
-
-
- (22 octobre ~ 20 novembre) – Période des brumes et des brouillards
-
-
Frimaire
-
-
-
- (21 novembre ~ 20 décembre) – – Période des froids (frimas)
-
-
-
-
- Mois d’hiver (terminaison en
ose)
-
-
- Nivôse
-
-
-
-
- (21 décembre ~ 19 janvier) – Période de la neige
-
-
Pluviôse
-
-
-
- (20 janvier ~ 18 février) – Période des pluies
-
-
Ventôse
-
-
-
- (19 février ~ 20 mars) – Période des vents
-
-
-
-
- Mois du printemps (terminaison en
al)
-
-
-
Germinal
-
-
-
- (21 mars ~ 19 avril) – Période de la germination
-
-
Floréal
-
-
-
- (20 avril ~ 19 mai) – Période de l’épanouissement des fleurs
-
-
Prairial
-
-
-
- 20 mai ~ 18 juin) – Période des récoltes des prairies
-
-
-
-
- Mois d’été (terminaison en
idor)
-
-
-
Messidor
-
-
-
- (19 juin ~ 18 juillet)-Période des moissons
-
-
Thermidor
-
-
-
- (19 juillet ~ 17 août)- Période des chaleurs
-
-
Fructidor
-
-
- (18 août ~ 16 septembre)- Période des fruits
-
Les saints avaient disparu, ils étaient remplacés par des légumes, animaux …etc.
Quelques exemples : -
-

V.III – LES UNITES DE MESURE
MESURES DE LONGUEUR
La toise : on utilise la toise équivalant à 2,045 m, généralement ramenée à 2 m surtout pour les mesures de surface (la toise carrée vaut 4 m2).
La canne : utilisée surtout pour la mesure des bâtiments d’habitation, soit 1,985 m.
Le pan, soit 0,20 m.
Le pied qui équivaut à 1 1/3 pan, soit 27 cm environ (en 1779).
MESURES DE SURFACE Le cadastre utilise la saulmée, la sétérée, l’eyminée et la cosse pour les terrains, la canne pour les surfaces bâties.
La toise carrée, soit 4m2
La canne carrée, soit 3,92 m² ou 4 m².
La cosse, soit 10 toises carrées.
La civayer, soit 100 toises carrées.
L’eyminée, 200 toises carrées.
La sétérée, 900 toises carrées.
La saulmée ou saumée, appelée également charge : 1600 toises carrées.
Pour les grandes distances on utilisait :
La lieue : 5 km environ.
La demi-lieue soit 2,5 km
MESURES DE POIDS
La livre soit 421 grammes et 42,1 kg pour le quintal de 100 livres.
MESURES DE CAPACITE
Encore plus que les autres unités, les mesures de capacité varient et diffèrent souvent même en fonction des objets à mesurer. Il arrive d’ailleurs souvent que les denrées ne soient pas mesurées mais vendues au poids comme le vin.
Le blé
Pour mesurer le blé on utilise :
L’émine qui vaut 45 livres soit 18,945 kg.
La demi-émine, 22,5 livres soit 9,472 kg.
La civayer, 5,625 livres soit l/8è d’émine, 2,368 kg.
La cosse, 2,250 livres soit l/20è d’émine, 0,947 kg.
La saumée, 336,150 livres ou 7,47 émines soit 141,519 kg.
La charge, 360 livres soit 8 émines soit 151,560 kg.
Le vin
Les mesures utilisées pour le vin sont :
La charge, 175 livres soit 73,675 kg. (50 pots)
Le barral, demi-charge, soit 87,5 livres soit 36,837 kg.
L’émine, demi-barral, soit 43,75 livres soit 18,428 kg.
Pour les petites quantités, on utilise ;
Le pot : 3,5 livres soit 1,473 kg
La filette : demi-pot, soit 1,75 livres soit 0,737 kg
La niège : quart de pot, soit 0,875 livre soit 0,368 kg.
LES MONNAIES
Afin de fixer la valeur approximative de la monnaie à l’époque considérée, je donnerai simplement, à titre indicatif, les prix de quelques denrées ou de divers services qui pourront être comparés avec les prix actuellement pratiqués, mais avec prudence cependant.
Les valeurs monétaires utilisées au XVIII° siècle, en valeur croissante sont :
L’obole,
Le denier, qui vaut 4 oboles
Le sol, qui vaut 12 deniers
La livre, qui vaut 20 sols.
Plus exceptionnellement nous trouvons
L’écu, qui vaut 3 livres,
Le louis, qui vaut 12 livres.
En 1706, il est question d’un double louis d’or, valant 27 livres 10 sols
GAGES, SALAIRES
Garde forestier et champêtre : 180 livres par an en 1766.
Régent des écoles : 150 livres par an en 1775 et 180 livres en 1781
Ouvriers agricoles, homme : 1 livre par jour ; femme : 10 sols par jour (deux fois moins)
Maçons : 1 livre 10 sols par jour
Manœuvres : 10 sols par jour (trois fois moins)
PRIX
Blé (la charge):
1762 : 22 livres,
1769 ; 20 livres
1777 : 28 livres
1781 : 32 livres.
Vin (la charge) :
1762 : 4 livres 10 sols
1769 : 4 livres,
1777 : 5 livres,
1781 : 5 livres.
V.IV – LA NOTION DE VASSALITE
La vassalité est à l’origine la situation de dépendance d’un homme libre (du latin médiéval vassus puis vassalus, serviteur) envers son seigneur par la cérémonie de l’hommage. La société féodale est une société solidement hiérarchisée et pyramidale. Ce système s’est développé à cause de l’affaiblissement de l’autorité publique après l’effondrement de l’empire carolingien (Xe – XIe siècle) : l’empereur, les rois et bientôt les princes territoriaux étaient incapables de faire régner l’ordre et d’imposer leur pouvoir aux seigneurs locaux. Un réseau de relations d’homme à homme s’est donc imposé, donnant des droits et des devoirs pour chacun d’entre eux, une pyramide sociale allant théoriquement du roi au grand seigneur, au seigneur, au vassal et arrière-vassal mais dont l’effectivité dépend de l’autorité du supérieur. Si l’autorité supérieure est faible, la pyramide s’écroule.
Ainsi les seigneurs de Saint André d’Olérargues ont toujours été les vassaux des évêques d’Uzès, eux-mêmes vassaux du Comte de Toulouse puis des Rois de France.
Des obligations réciproques.
Même si la vassalité allie deux hommes libres, il est cependant évident que ces hommes ne sont pas égaux : le seigneur a davantage de pouvoir que le vassal. En effet, il dispose du droit de ban, c’est-à-dire le droit de punir, contraindre et juger. Le vassal se met sous la protection d’un plus puissant. Néanmoins cette puissance doit beaucoup au nombre, à la loyauté et la puissance relative de ses vassaux, d’où la réciprocité. On parle donc de contrat synallagmatique car il engage les deux parties à l’acte, qui ont des obligations l’une envers l’autre. Ça fait un peu penser à des structures mafieuses actuelles … !
Les devoirs du vassal envers son suzerain
(Par exemple les devoirs du seigneur possédant Saint André d’Olérargues vis-à-vis de l’évêque d’Uzès).
Le contrat peut se résumer à l’auxilium, c’est-à-dire l’aide, et au consilium, le conseil.
Les devoirs du vassal envers son seigneur sont d’abord des interdictions : le vassal ne doit pas nuire à son seigneur, à sa famille et à ses biens.
Le vassal doit l’aide militaire à son seigneur : lorsque celui-ci est attaqué, le vassal doit venir avec ses armes pour le défendre. Le vassal est aussi chargé de la garde du château (estage) et de l’escorte de son seigneur. Quand le seigneur attaque un autre, le service militaire (ost) ou (host) est limité à 40 jours. Mais le vassal reste évidemment aux côtés de son seigneur si le conflit dépasse cette durée.
Il sera dédommagé en argent au-delà de 40 jours de combat. (Des heures supplémentaires en quelque sorte).
Le vassal doit aussi assurer une aide financière, l’aide aux 4 cas suivants : le vassal doit donner de l’argent ou des cadeaux à son seigneur lorsque celui-ci marie sa fille aînée, lorsqu’il adoube son fils aîné, lorsqu’il part à la croisade et lorsqu’il est fait prisonnier et qu’il doit une rançon. D’où l’intérêt d’avoir pour suzerain un évêque !
Enfin, le vassal est astreint à fournir des conseils à la demande de son seigneur : il doit participer aux assemblées féodales, aux cours de justice du seigneur ainsi qu’aux fêtes liturgiques. L’ensemble des vassaux d’un seigneur est ainsi soudé par ces temps forts.
Les devoirs du suzerain envers son vassal
Les dépenses du vassal sont donc considérables : il doit acheter et entretenir un cheval et des armes ; il doit pouvoir se nourrir et assurer un certain train de vie. C’est pour répondre à ces exigences que le seigneur peut donner un fief à son vassal. Ce fief est en général une terre qui rapporte des revenus au vassal. Le fief est pris sur les terres ou les revenus du seigneur.
Le seigneur doit également protéger son vassal contre les ennemis que ce dernier pourrait avoir et lui rendre bonne justice. Le problème du fief. (Voir aussi le lexique en fin d’ouvrage)
Propriété éminente et propriété utile, le concept de propriété au Moyen Âge
Plus exactement il s’agit de la conception féodale de la propriété immobilière. Ainsi on parle de propriété éminente pour le seigneur suzerain qui est directement le propriétaire des terres concédées au vassal (qu’il soit seigneur ou roturier). Et on parle de propriété utile pour le vassal, c’est-à-dire le droit d’exploiter le fief pour son propre compte. Si un seigneur possède directement des terres et qu’il les exploite pour son propre compte ou par un tenancier (ou un vassal) celui-ci n’est pas lui-même vassal d’un autre. En général, le suzerain (ou seigneur concédant) n’aliénait qu’une partie de son domaine et exerçait la propriété utile d’une autre partie du domaine.
Ainsi les rois francs exerçaient la propriété utile sur les terres parisiennes, mais n’exerçaient qu’une propriété éminente pour les autres domaines.
Nature du fief
Le principe de donner un bien foncier en échange de services, notamment militaires, remonte à l’Antiquité tardive. À l’époque carolingienne, cette terre s’appelle bénéfice ; au Moyen Âge central, il est nommé fief dans les textes. Le mot fief a donné ensuite l’adjectif féodal.
Le fief peut être de plusieurs natures :
Évolution du statut du fief.
Le fief entre progressivement dans l’héritage des vassaux. Au début, le fief était accordé par le seigneur à son vassal à titre viager. Le seigneur organisait donc une nouvelle cérémonie d’hommage pour l’héritier. Mais de plus en plus, le fief devient transmissible, moyennant une somme d’argent (droit de relief). Peu à peu, le but de l’hommage n’est plus le service et les devoirs réciproques mais bien le fief.
Les vassaux multiplient donc les hommages pour accumuler les fiefs. Le problème vient quand deux seigneurs ayant un vassal en commun entrent en guerre.
La cérémonie d’entrée en vassalité.
Par la cérémonie de l’hommage (à ne pas confondre avec celle de l’adoubement qui fait d’un homme un chevalier), le vassal devient l’homme d’un seigneur. Les documents qui décrivent cette cérémonie sont abondants, aussi bien les textes que les images, nous avons vu quelque exemples d’hommages des seigneurs de Saint André d’Olérargues à l’évêque d’Uzès au chapitre IV.
L’hommage est une cérémonie publique qui se déroule en général au château du seigneur, devant témoins. Est félon le vassal qui rompt le contrat de vassalité. Le seigneur peut alors proclamer la saisie de son fief rarement mise en œuvre jusqu’en 1202 lorsque Philippe Auguste proclame la saisie à Jean Sans Terre, saisie qu’il appliquera pour montrer l’exemple. Cependant, si le seigneur manque à ces engagements, le vassal peut aller se plaindre au seigneur du seigneur, pour lui demander la protection et c’est lui qui décidera du sort du seigneur intermédiaire (il peut donner le fief au vassal définitivement sans que le seigneur puisse en bénéficier).
V.V – LA NOTION DE SERVAGE
Sa différence avec l’esclavage provient du statut du serf, qui jouit d’une personnalité juridique. De ce fait, le serf n’est juridiquement pas considéré comme une « chose », un « bien meuble », mais comme une « personne », liée par un contrat (obligation) à une autre personne.
Ainsi, le serf n’appartient pas à son seigneur, mais est attaché à la terre (souvent un fief, dont le propriétaire ultime est plus haut dans la chaîne de vassalité), la contrepartie étant qu’il ne peut être chassé de cette terre, puisqu’il ne fait qu’un avec elle ; en outre, il peut posséder des biens, peut exercer une action et témoigner en justice, peut contracter (mariages, contrats de vente) plus ou moins librement (le plus souvent entre eux et avec accord du seigneur suivant l’objet de la vente).
Mais, s’il n’est pas complètement dénué de droit d’héritage, celui-ci est dans tous les cas fortement limité, en particulier par l’échute : en l’absence d’héritier direct, ses biens reviennent à son seigneur lors de son décès. Ce qui lie le serf à son seigneur est un contrat analogue du contrat de vassalité : il lui doit fidélité et se trouve à la base de la pyramide féodale. Cette fidélité, comme tout lien féodal, a une contrepartie : le seigneur lui doit protection.
Servage personnel ou servage réel
Le servage pouvait être soit personnel, soit réel.
Dans le servage personnel, c’est la personne qui a le statut de serf, indépendamment de son activité ou de sa profession. Le serf est attaché à une terre qu’il doit exploiter soit pour son propre compte, ou au compte de son seigneur. Il est soumis à l’obligation juridique d’y rester, et doit accepter son nouveau seigneur quand cette terre est léguée ou vendue. Ce statut est héréditaire, on est serf de père en fils.
Pour devenir libre, le serf devait acheter sa franchise, ou alors s’enfuir. Mais, le seigneur avait droit de suite, qui l’autorisait à poursuivre celui qui était en fuite de son domaine, et des accords d’entre cours par lesquels les seigneurs s’engageaient à se livrer mutuellement les fugitifs.
Toutefois, à partir du Xe siècle, l’église crée avec le roi et les comtes des terres de refuges ou sauvetés qui font bénéficier ceux qui s’y installent d’un droit de suite qui les rendait libres, eux et leurs familles. C’est le développement du nombre des sauvetés, des villefranches puis des bastides (villes neuves) qui fera disparaître complètement le servage. On retrouve les noms de certaines régions ainsi concernées : Villefranche, Sauveterre, Francheville, Franche-Comté, etc.
Le servage personnel avait disparu après la guerre de Cent Ans, car le manque de main-d’œuvre (la Grande Peste à elle seule a emporté entre 1/4 et 1/3 de la population) a favorisé la concurrence entre nobles et le débauchage des serfs. À cette époque, les nobles du voisinage proposaient aux serfs de racheter leur contrat pour venir s’installer librement sur leurs nombreuses terres en friche, ce qui obligeait le noble local à faire de même pour conserver son personnel.
Dans le servage réel, le servage est un droit réel, ou plutôt une restriction des droits attachés à un domaine foncier. Ils se transmettent avec la propriété de celle-ci. Un homme libre qui acquiert une propriété servile devient serf. En plus de certaines servitudes, ce droit réel consistait essentiellement dans le fait de ne pas pouvoir vendre sa terre ou sa maison à un tiers, ni la léguer à son successeur. À la mort du serf, tous ses biens immeubles revenaient au seigneur qui, presque toujours, les concédait à nouveau à ses enfants capables de lui succéder. Le servage réel était plus connu sous l’appellation de mainmorte ou d’aubaine. Les terres non libres, ou de mainmortes, étaient aussi appelées « précaires » et correspondaient au statut de louage qui a été généralisé après la Révolution par le Code civil.
Les étrangers avaient en France et à titre personnel un statut équivalent à celui de serf réel : ils ne pouvaient à leur mort, transmettre à leurs héritiers leur patrimoine immobilier qui revenait au Domaine.
Par ordonnance du 8 août 1779 Louis XVI abolit le servage sur les domaines royaux de France. Néanmoins, l’ordonnance ne fut guère appliquée, car il aurait fallu que le roi rachète aux propriétaires supérieurs des terres en mainmorte la valeur patrimoniale de ce droit qui revenait à rendre tous les fermiers des abbayes, propriétaires du domaine qu’ils exploitaient.
Après la révolution, lors de la vente des biens nationaux (c’est-à-dire les anciennes possessions de l’Eglise et de la Couronne), c’est l’ancien statut de servage réel, rebaptisé « louage d’ouvrage » puis fermage, qui a été préféré et généralisé en 1801 par le Code civil des Français : l’ancien seigneur ayant été remplacé par un bourgeois propriétaire et l’ancien censitaire par un locataire libre, c’est-à-dire précaire.
V.VI – LA COMMUNAUTE VILLAGEOISE.
La communauté villageoise tend, en effet, à se confondre avec la communauté paroissiale ; c’est d’ailleurs dans l’église, ou sous son porche, que se font les «assemblées d’habitants» annoncées en chaire par le curé et appelées au son de la cloche; le compte rendu, s’il y a lieu, est rédigé par le greffier ou notaire seigneurial, espion du seigneur dans ces réunions dont la tenue n’est pas toujours compatible avec la dignité du lieu.
Les séances sont présidées par un ou plusieurs syndics (ou procureurs), représentants légaux de la communauté, qui tiennent souvent aussi les charges de marguilliers ou fabriciens (c’est-à-dire gérants de la communauté proprement paroissiale).
Ces hommes sont généralement parmi les plus aisés du village et conservent leurs fonctions au sein de leur famille. D’ailleurs, pour avoir valeur, il suffit que l’assemblée réunisse «la partie la plus saine de la population», c’est-à-dire les chefs de famille les plus riches et les plus socialement stables. Cette restriction dans la composition des assemblées se sent à la lecture des cahiers de doléances de 1789, rédigés dans le cadre des communautés villageoises, et qui ne reflètent que rarement les plaintes des plus défavorisés.
Lorsque ces villages devinrent des communes, ce furent tout naturellement les mêmes familles de syndics qui exercèrent les nouvelles fonctions municipale
V.VII – LES IMPOTS. LA TAILLE et la GABELLE
La taille
À l’origine, le terme désigne un bâton de taille, c’est une baguette de bois fendue, permettant de conserver la trace de valeurs chiffrées au niveau d’encoches qui permettent de conserver la preuve de ces valeurs. C’est un système de comptabilité accessible aux personnes ne sachant ni lire ni écrire.
La taille seigneuriale apparaît dans la deuxième moitié du XIe siècle. Elle a pour but de faire contribuer les communautés villageoises aux charges de la seigneurie, en compensation de la protection accordée par le seigneur, son montant étant fixé « à merci » (arbitrairement) ou définitivement ce qui déclenche nombre de différends entre les seigneurs et les redevables de la taille.
Au XIIe siècle, du fait du mouvement de croissance agricole, la tendance générale est à l’octroi de chartes de franchises par le seigneur à l’égard des colons et défricheurs. Généralement il s’agit d’une redevance par tête de bétail ou sur les récoltes, payée en nature ou en argent.
A la fin de la Guerre de Cent Ans, le 2 novembre 1439, les États généraux, réunis depuis octobre à Orléans, décident l’entretien d’une armée permanente pour pouvoir bouter définitivement les derniers anglais hors de France. Cette décision déclenche une révolte des nobles qui ont gain de cause et cet impôt sera prélevé dans chaque famille du royaume, à l’exception des nobles et des clercs : c’est la « taille ». Ce nouvel impôt annuel sera aboli à la Révolution.
La taille royale peut prendre deux formes différentes suivant les régions :
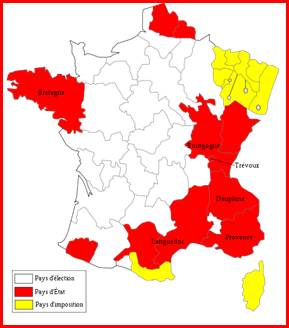
Figure 144. Numérisation de l’Auteur. Source Wikipedia.
Taille personnelle dans la plupart des pays d’élection, elle est répartie arbitrairement d’après les signes apparents de richesse et en fonction des réseaux d’influence, c’est la formule la plus courante. L’imposition personnelle se base sur le feu, c’est-à-dire l’âtre autour duquel sont rassemblés le chef de famille et ses enfants, cette appellation a donné le terme de foyer fiscal. Seul le nom du chef de famille est indiqué dans les registres. Son montant est fixé arbitrairement en fonction des besoins seigneuriaux et des capacités de la population, d’où la plainte des assujettis d’être « taillables et corvéables à merci ».
Taille réelle dans la plupart des pays d’État, elle concerne les biens fonciers. Elle est déterminée à partir du cadastre (du compoix en Languedoc) qui indique la surface et la valeur des terres de chaque communauté. Un noble sera taxé seulement sur ses biens roturiers. La taille réelle assise sur la terre et la taille personnelle frappaient les revenus. Dans les pays d’État, c’étaient les États qui répartissaient la taille entre les paroisses de la province. Le recouvrement est perçu par des hommes désignés dans la population de la paroisse. Ces personnes sont responsables sur leurs biens.
La taille sous Henri IV représente environ 60 % des ressources du royaume, 25 % à la fin du règne de Louis XIV. L’état se finance alors beaucoup par emprunts et impôts indirects. Et oui déjà !
La Gabelle.
Le sel fut longtemps le seul moyen de conserver les aliments et était donc un élément stratégique.
Rappelons que le sel était un monopole royal.
A visiter les Salines Royales d’Arc et Senans dans le Jura. Ce monopole dura jusqu’à la révolution. Il était stocké dans des greniers à sel où la population l’achetait taxé et en toute petite quantité. La gabelle représente, à l’époque moderne, environ 6 % des revenus royaux.
Avec le sel, on fabriquait des salaisons et l’on séchait poissons et viandes douces. Il était également un composant nutritif indispensable pour le bétail. Enfin, il fut sous l’Ancien Régime utilisé comme monnaie d’échange et il possédait même une fonction de salaire, dont on retrouve le sens étymologique dans salarium en latin qui signifiait « ration de sel » puis, par extension, la pratique du traitement, du salaire à l’époque romaine.
V.VIII – LA FORET.
« Depuis combien de siècles fait-on fi de vous, pauvres et chers boisements méridionaux!… Cependant la forêt méridionale compte de nobles ancêtres, leurs noms tintent encore bien à nos oreilles, et leurs lambeaux témoignent de leur ancienne splendeur »
(DUCAMP R. et FLAUGERE A. Pour le réveil et l’honneur des forêts méridionales. Rev. Eaux et forêts t. 66 1928.
Pour ce paragraphe, je vais me référer à ce que Michel COINTAT a écrit, dans les années 70, dans la « revue forestière française ».
Boisement primitif.
Au milieu de la garrigue, la forêt domaniale de Valbonne, et la forêt de Cuègne, entre St André d’Olérargues et Saint-Marcel-de-Careiret, sont les témoins de boisements primitifs satisfaisants.
La charte communale accordée le 6 mai 1280 par Guillaume de RANDON aux habitants de Génolhac, montre qu’au XIII° siècle on trouvait sur les flancs du Mont Lozère des sapins propres au sciage. De nombreuses forêts ont d’ailleurs disparu dans un passé récent. Dans son Histoire Naturelle, M.de Gensanne signale, en 1775, que l’Aigoual était couvert de vastes forêts de pins sylvestres et de hêtres.
En vertu de la loi du 25 mars 1831 sur l’aliénation des biens nationaux, la forêt de Valbonne fut mise en vente en 1833, elle est toujours domaniale aujourd’hui, elle a eu la chance, faute d’acquéreurs, d’être conservée. Dix-sept lots (576 ha) de la forêt de Campagne près de Nîmes ont été cédés pour 487 400 francs. Les quinze lots restants furent adjugés en 1853, et achevèrent le morcellement et la ruine de ce massif.
Il est, certainement, des pentes calcaires qui n’ont jamais retenu les sols, qui ont dû être toujours le domaine de la garrigue. Mais par contre, en bien des endroits, la forêt a dû couvrir les hauteurs et les collines. Les documents historiques en font foi.
Les magnifiques reboisements de l’Aigoual et du périmètre de la Cèze, où les pins maritimes des sables et grès de la région de Saint Laurent-des-Arbres, Tresques et Chusclan, montrent que la restauration est possible. La colonisation progressive des taillis de chêne vert par le chêne pubescent, la présence du hêtre à Valbonne, l’adaptation et l’introduction du cèdre, sont un encouragement à l’épanouissement d’une sylviculture méditerranéenne, et la preuve irréfutable qu’il est possible de rattraper peu à peu l’ambiance des paysages perdus.
Les noms de lieux
De nombreux noms de villages, de rivières et de lieux, rappellent la forêt et l’importance des terrains autrefois boisés dans le département du Gard. Certains font allusion au chêne vert ou « yeuse » (Quercus ilex): Euzet-les-Bains, Saint-Michel d’Euzet; Uzès, l’Uzège, l’Euziere. D’autres au chêne blanc ou « rouvre » (Quercus pubescents): La Rouvière, Rouveyrolle, Rouret, Rouveyrette.
Dans la partie montagneuse du département, et principalement dans les régions granitiques, les noms prouvant la présence du hêtre ou « fayard » sont très communs: La Fage, la Faye, les Faux, la Fajole, Quatrefages, Col de Faubel, etc…
L' »alisier » apparaît dans les noms de quelques rivières: l’Auzon, l’Auzonnet, l’Alzon.
« Castaniers » se rapporte au châtaignier, nom qui se retrouve jusque dans la région calcaire où, de bonne heure, le châtaignier a été introduit dans les terres rouges décalcifiées des plateaux urgoniens et les terrains cénomaniens comme à St André d’Olérargues.
D’autres essences sont représentées : l’aulne ou « verne », dans Saint-Laurent-la-Vernède, le « saule » dans Sauzet, le « peuplier » dans les Aubes, Aubais, le « frêne » dans les Fraisses, le « noyer » dans Nougaret, le « figuier » dans Figaret, etc…
Certains noms de villages ou de cantons se rapportent simplement à la forêt en général: Bouquet, Saint-Laurent-des-Arbres, Bréau(bois clos),Brueys, les Issarts (forêt défrichée), ou encore précisent une caractéristique du sous-bois : La Bruguière, les Brugas, Brugairolles (bruyères), Boisset, Boissières, les Buissières (buis), Darboussas (arbousier), le Cornier (cornouillier), etc…
Ce n’est pas sans raison que les paysans d’autrefois ont désigné leur village, et il n’existe pas de meilleur enseignement que cette dénomination de tous les lopins de terre constituant les finages (C’est l’ensemble des terres, aux limites imprécises jusqu’à l’époque moderne, nécessaires à la vie d’une communauté rurale).
Il est ainsi surprenant de rencontrer autant de noms de lieux rappelant la forêt dans un département méridional comme le Gard, recouvert principalement aujourd’hui de garrigues et landes qui sont en majorité.
Indirectement, certains noms sont un souvenir de la forêt: comme le village de Verfeuil, qui tire son origine du latin viride folium (la verte feuille), et qui aujourd’hui, n’offre qu’un coteau stérile et sec envahit de buis.
Les eaux vives de l’Aiguillon et de l’Avègue, aux noms significatifs ont disparu, et le village de Verfeuil, aujourd’hui couronné de chênes kermès et de buis, n’aurait même plus d’eau pour ses habitants si des forages plus récents n’avaient été faits. Seule la vieille tour du château, semble implorer le ciel dans sa détresse.
J. Roux dans sa Notice Historique sur les Châteaux de Verfeuil et de la Roque en 1826 disait :
« De nos jours, soit que la forêt de Verfeuil, éclaircie par la hache cruelle du bûcheron qui l’a dépouillée de ses chênes tant de fois séculaires, ne puisse comme autrefois féconder les sources primitives, soit que le fait historique d’une malédiction lancée par Saint Bernard contre un Viride folium rebelle à sa mission apostolique se rapporte à ce Verfeuil, dont l’aspect desséché semble, surtout à la saison d’été, rendre son beau nom illusoire… »
Cependant j’encourage le lecteur à aller voir à Verfeuil, le magnifique chêne vert quasi millénaire qui se trouve derrière l’église actuelle. C’est un miracle que la hache du bucheron l’ait laissé en vie si longtemps.
Déboisement et défrichement.
L’agriculture naissant, il y eut, dès le Néolithique, occupation du sol, après déboisement et défrichement. La population augmentant, les défrichements s’intensifièrent. Les déboisements obligatoires restèrent utiles tant que l’équilibre Ager-Saltus-Silva fut respecté. C’est-à-dire l’équilibre entre les champs cultivés, les terres sauvages et de pâture et la forêt. Ils devinrent nocifs quand, par la faute d’une agriculture extensive et précaire où la jachère occupait la moitié de l’assolement, cet équilibre fut rompu au détriment de la forêt.
Comme partout ailleurs, les défrichements dans le département du Gard correspondent à des périodes de paix et de prospérité, alors que les longues années de troubles ou d’invasions ont favorisé l’extension de la forêt.
Les nombreux dolmens de la région de Barjac et du Garn, qui parsèment les massifs forestiers, les tumuli et les ateliers mésolithiques des forêts de Saint-Marcel, Cavillargues et de la Bastide-d’Engras, sont une preuve de l’occupation primitive des plateaux karstiques de l’Uzège.
Toutefois, le premier grand défrichement débuta avec l’organisation de la Narbonnaise par les Romains. Les déboisements romains n’eurent malheureusement pas toujours un but économique ou agricole, mais quelquefois un but stratégique, telle l’ancienne forêt des Massaliotes (habitants de Marseille, Massalia), rasée par JULES CÉSAR.
Dès le VI° siècle, l’influence des moines fut prépondérante. Par exemple, les bénédictins du Camp-de-César, au-dessus de Laudun, asséchèrent et défrichèrent la basse vallée de la Tave, et fondèrent le village de Connaux. Un peu plus tard, d’autres moines organisèrent l’étang de Pujaut.
Leur action se poursuivit au Moyen-Age et on leur doit l’aménagement du terrain en «faysses».
En I204, les Chartreux s’installèrent dans le grand massif forestier de Notre-Dame de-Bondilhon, auquel ils donnent le nom de Valbonne. Ils créent aux dépens de la forêt, plusieurs domaines cultivés, le Monastère, le Chapelas, les Cellettes, Cadenet, Jols … mais les Chartreux limitèrent les abus, gérèrent sagement leurs domaines forestiers, et apportèrent quelquefois avec succès, des améliorations importantes.
A la fin du XIII° siècle, les défrichements ont atteint leur maximum, mais la prospérité des campagnes françaises qui, au début du XIV° siècle, faisait l’admiration des étrangers, a été ruinée par les calamités de ce siècle et en particulier par la guerre de Cent ans. La forêt reprend alors ses droits.
Au XVI° siècle, les terres rongent à nouveau la forêt et la dentèlent, mais les guerres de Religion stoppent cette évolution. Les disettes et les famines du XVIII° siècle sont par la suite la cause de défrichements abusifs et désordonnés.
Tous les pattus (terres communales) et vacants, toutes les dépressions, possédant un peu de terre sont mis en culture. Ces défrichements sont à l’origine des nombreuses enclaves particulières qui trouent les taillis communaux et dont les terres sont aujourd’hui abandonnées. Il suffit de se promener dans les bois pour constater ces multiples enclaves, toutes soigneusement bornées de murets de pierres.
La nécessité des défrichements intenses a existé tant que l’agriculture est restée extensive. Les Rois de France avaient suivi une politique forestière indécise et contradictoire. Jusqu’en 1518, les défrichements sont libres. Si ensuite, ils sont interdits théoriquement jusqu’au début du XVIII° siècle, ils se poursuivent en fait. Une série d’hivers rigoureux aboutit à l’Ordonnance de 1709, qui autorise les défrichements. Les Ordonnances de 1719 et 1735 reviennent en arrière, mais les famines se succèdent et les Ordonnances de 1764, 1766 et 1772 favorisent le déboisement.
En l’an XI de la République, interdiction de défricher pendant 25 ans, mais l’Ordonnance de 1819 entérine les usurpations qui ont eu lieu dans les communaux.
Nous avons vu au chapitre IV les déclarations de régularisation des défrichements sauvages réalisés par des habitants de St André d’Olérargues.
Au XVIII° siècle et au début du XIX°, les procès sont nombreux entre les municipalités et les particuliers, pour usurpations dans les bois communaux. La plupart des compoix sont révisés pour y incorporer de nouvelles parcelles nées au milieu des garrigues et des yeuses.
A Saint André d’Olérargues, 151 parcelles d’une contenance de 41 ha ont été usurpées et défrichées de 1772 à 1836.
Ainsi déjà en 1763 les consuls de St André d’Olérargues déposent une demande de poursuite auprès de Monseigneur le Vicomte de St Priest Intendant en Languedoc. Ci-après les doubles des documents de cette demande de poursuite et de financement des frais ainsi que la réponse de l’Intendant inscrite sur le même document. Ce document est suffisamment bien écrit pour qu’il ne soit point nécessaire que je le transcrive. Admirons l’écriture !
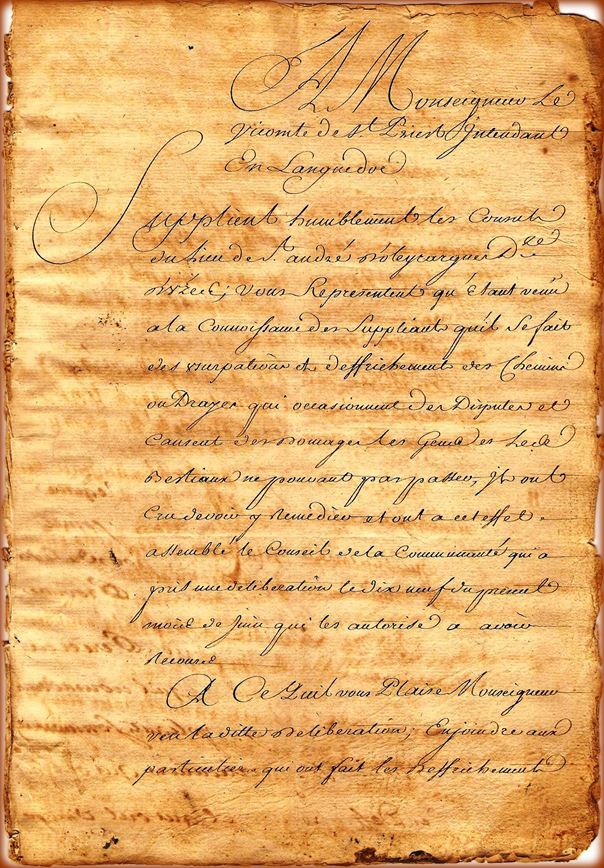
Figure 146. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales. .
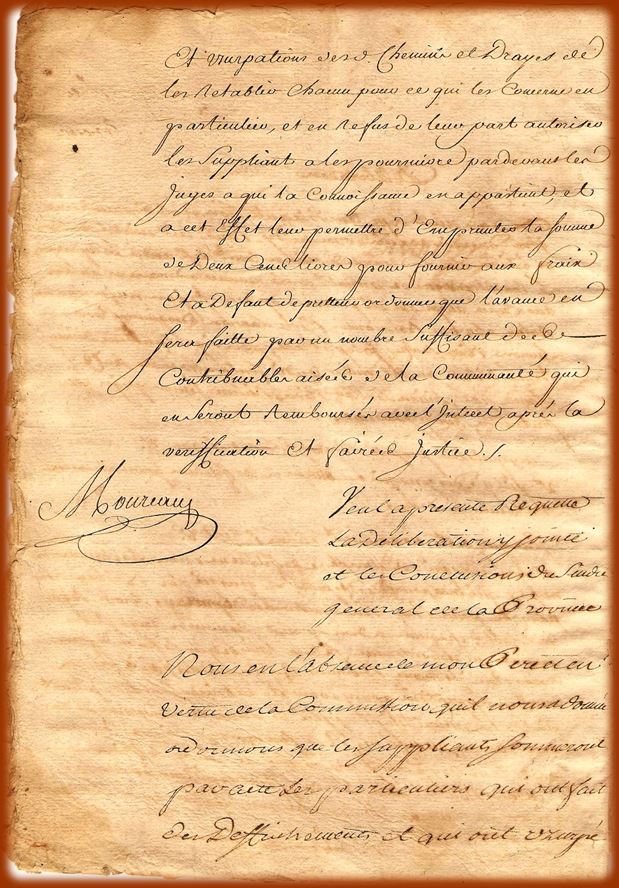
Figure 147. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales. .
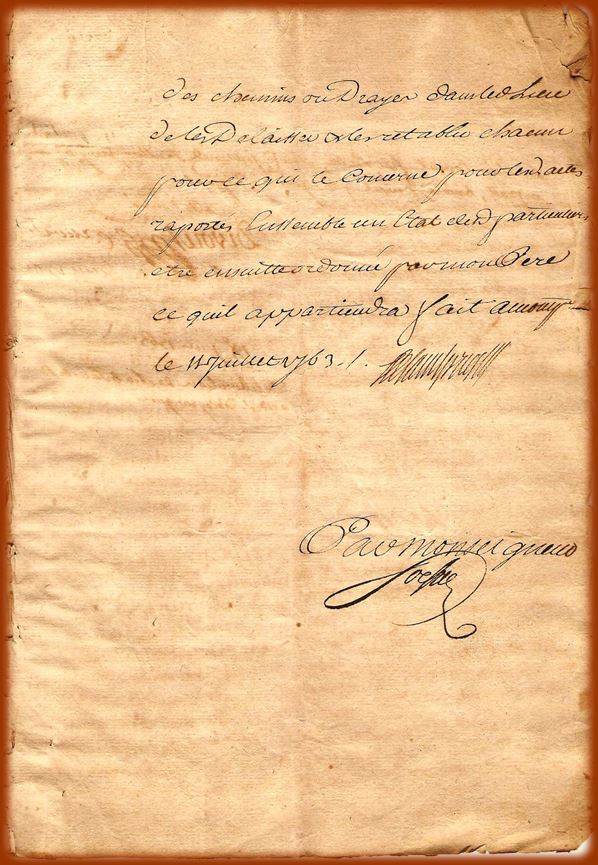
Figure 148. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales. .
A Saint-Marcel-de-Careiret, la commune obtint en 1850 la destruction du régime forestier de 45 hectares aux dépens de la belle forêt de Cuègne. Ces 45 hectares furent défrichés et les première récoltes de blé furent absolument impressionnantes. Malheureusement, cinquante ans plus tard, le roc était à nu et devenu stérile.
Grâce à la transformation de l’agriculture, à l’apparition des prairies artificielles, à l’emploi des engrais minéraux, au perfectionnement de l’outillage, grâce aussi au Code forestier de 1827, la fureur du défrichement s’éteignit vers 1850, et déjà à partir de 1830, elle avait progressivement fait place à un mouvement de reboisement. Toutefois, il y eut encore jusque vers 1900 quelques dossiers de défrichements.
La dégradation de la forêt
En 1936 George KUHNHOLTZ LORDAT disait : « C’est à cet ensemble de ruines, à ce paysage étincelant, rugueux et piquant, à qui l’on a donné le nom de garrigue, c’est une œuvre essentiellement humaine. »
A cause d’une féodalité moins stricte qu’ailleurs, la forêt languedocienne fut de très bonne heure soumise aux dévastations et déprédations. Dès le XIV° siècle, une grande partie des forêts gardoises avait été transformée en pâturages, que l’on trouve désignés dans les archives sous le nom de pattus ou pâtis.
L’Ordonnance de 1669 a eu un heureux résultat en fixant les rotations des taillis à un minimum de 10 ans. Par contre, la réserve de baliveaux a été inefficace, car trop claire, dans un climat général trop sec. C’est encore le cas aujourd’hui, où les coupes de bois autorisées ne laissent aucun arbre debout !
L’Intendant du Languedoc précisait dans son rapport du 4 Septembre 1786, tant les abus étaient importants : « Il n’y aura dans quatre ans plus de bois en Languedoc, il est d’une nécessité indispensable d’établir un ordre dans cette partie d’administration »
La Révolution augmente encore le désordre. La forêt domaniale de Valbonne, gérée jusqu’en 1815 par les communes limitrophes, est entièrement recépée (taillée) et incendiée.
L’âge d’exploitation des taillis est abaissé dans des proportions désastreuses: 10 ans pour Baron (arrêté préfectoral du 20 décembre 1809), 15 ans pour Saint-Laurent-la-Vernède, etc…
Les coupes s’avèrent impossibles dans certaines forêts communales.
En 1787, la communauté de Tresques se plaint que certains grangers (exploitants agricoles) arrachent les chênes avec pics et bèches au lieu de les couper, que d’autres défrichent, que d’autres enfin prennent avec abus du bois pour leurs fourneaux, à tel point que les bois sont entièrement dégradés et ce n’est pas une spécificité de Tresques, c’est valable pour toute la région.
Le préfet Dunors écrit en l’an X de la Révolution « le territoire de Nîmes est dépourvu d’arbres. Ce ne sont que des garrigues stériles dont l’aspect afflige le bon citoyen ».
En 1822, Cavillargues demande l’exploitation d’une coupe qui n’a que 8 ans. Les bois sont tellement broutés et dévastés par les arrachis, qu’il faut quand même les recéper. A Vallabrix, 96 hectares ne sont peuplés que de chêne kermès « arrachés journellement ». Profitant de la révolution de 1830, les habitants de Saint-Paulet-de-Caisson coupent 500 réserves de la forêt communale.
En 1820, les documents disent que les bois ont été dévastés et pratiquement détruits par le pâturage et les arrachis des habitants, à Remoulins 1820, à Saint-Quentin, à Serviers, à Poulx (1835), à Sainte Anastasie (1837).
Les causes de la dégradation.
La ruine des forêts est la conséquence de trois facteurs traumatiques principaux, qui de tous temps ont été les mêmes : la coupe abusive, le pâturage et l’incendie.
La coupe abusive :
De très bonne heure des droits d’usage au bois importants ont été accordés par les seigneurs aux habitants des villages : droit au bois mort, au mort-bois , et au « bois vert » pour l’araire (genre de charrue en bois, plus généralement les outils de bois) et la construction. Malgré des chartes et des transactions nombreuses et diverses, les droits devinrent rapidement des sources d’abus.
Malgré les règlements, les abus se développèrent rapidement. Ils se concentrèrent au plus près des villages, ce qui est humain.
Pour Verfeuil, le rapport forestier du 10 juillet 1856 précise :« Les bois situés à l’Est sur toute la longueur du Nord au Sud, et sur la moitié de la hauteur des coupes, par l’effet du voisinage de la commune, du mas et du hameau, ont été pillés, arrachés, saccagés, d’une manière désordonnée. On ne voit que quelques cépées éparses. Il arriverait que des coupes entières ne vaudraient même pas la délivrance, tandis que les parties supérieures plus éloignées des habitations sont meilleures… »
Sous l’Ancien Régime, les seigneurs ont cherché à réduire les droits d’usage, dans le but surtout d’arrêter les abus d’exploitation, et les procès ont été nombreux à ce sujet. Seul le cantonnement des usages, origine de la plupart des forêts communales actuelles, a permis de supprimer les litiges. Dans les cas normaux, la commune héritait en pleine propriété d’environ le 1/3 de la forêt. C’est le cas de Verfeuil, où le jugement du 11 mai 1837 attribue à la commune les 5/16 du massif, dans la partie la plus près du village, mais également la plus dégradée. Les cantonnements ont également tenu compte des prescriptions spéciales contenues dans les transactions antérieures.
A Saint André d’Olérargues en 1834 il ne revient que le 1/5 de la surface au seigneur, mais celui-ci garde le plus beau canton.
Quelquefois, les droits d’usage étaient tellement étendus qu’ils équivalaient presque au droit de propriété.
Si M. de BRUEYS, seigneur de Saint-André d’Olérargues n’a obtenu lors du cantonnement que le 1/5 de la surface c’est parce qu’en 1772, devant les droits des habitants il leur avait abandonné la totalité de ses droits en se réservant seulement le quart du produit des coupes.
Il en est de même à Saint-Laurent-la-Vernède où dans la transaction du 22 juillet 1758, qui et encore en vigueur, le seigneur s’est également réservé le quart du produit des coupes et de tous les dommages, sans participer ni aux impôts ni aux dépenses de gestion.
Le régime du taillis et les courtes rotations de coupes, en découvrant le sol brutalement et trop souvent ont également contribué à la dégradation des peuplements. Les exploitations à 10 ans n’étaient pas rares.
Les résineux, puis les espèces feuillues améliorées et sensibles, hêtre, chêne rouvre, pin, chêne pubescent, ont disparu, et seul le chêne vert a pu résister.
Il faut d’un autre côté ajouter qu’autrefois les paysans tiraient de la forêt bien d’autres produits que le bois d’œuvre et le bois de chauffage, et utilisaient jusqu’à la moindre brindille. La forêt a forcément souffert de ces exploitations intensives.
Les fagots allaient chez les boulangers et les fabricants de chaux. L’écorce à tan (tannage du cuir), depuis le XVIII° siècle avait pris une importance considérable et a été une des causes qui ont empêché l’allongement des rotations des coupes de bois au XIX° siècle. C’est en effet vers 8 ans que le chêne vert produit la meilleure qualité d’écorce.
Avant la culture de la garance, le chêne kermès était très recherché pour ses cochenilles appelées aussi vermilières. L’Intendant du Languedoc : Le Nain, soucieux de maintenir la production du vermillon, interdit en 1774 « de couper aucun des arbrisseaux, appelés garouilles (nom dialectique du chêne kermès), et dont les graines sont propres à la teinture ». Au XIX° siècle, le chêne kermès était également exploité pour le chauffage.
Le buis, le genêt, étaient utilisés comme litière. La bruyère servait à la fabrication des balais, et à l’élevage des vers à soie. Les genévriers et les acacias sont toujours employés pour faire des piquets de vigne.
La délivrance des produits du sous-bois a été réglementée, par un arrêté préfectoral du 20 novembre 1843. A Lussan, on exploitait encore en 1908, 20 000 bottes de buis par an.
Les truffes, les glands, les arbouses, les plantes aromatiques comme le thym, la lavande, le romarin, l’aphyllanthe (sorte d’œillet bleu) pour la fabrication des brosses, etc. étaient également très recherchés.
Trop souvent effectuées avec arrachis à l’aide de pic et pioches, les exploitations permises ou non, ont été particulièrement néfastes.
. Enfin, le développement de l’industrie eut déjà à cette époque, une influence considérable. Les industriels destructeurs de bois et les usines mangeuses de bois furent nombreux.
Les fabricants de chaux, dont on retrouve les fours ruinés dans les garrigues calcaires, ont été les plus grands dévastateurs de forêts.
Viennent ensuite les verriers, qui dans les verreries du Chapelas et du Mas de Jols, ruinèrent une partie du massif de Valbonne.
Les boulangers utilisaient, surtout pour les fours, des fagots et exploitaient des quantités de jeunes bois. Les tanneurs surexploitèrent les forêts de châtaignier et les taillis de chêne vert.
Les charbonniers étaient surtout néfastes, parce qu’ils arrachaient les souches de chêne vert, où le bois est le plus dense.
Les teinturiers (vermillon, puis garance), les industries locales comme les sabotiers du Mont Aigoual, comme les tonneliers de Bagnols, ou les distillateurs de la région viticole, contribuèrent à la régression de la forêt. Au XVIII° siècle, on a interdit l’extraction du minerai de fer dans la forêt de Valbonne, de peur que cette dernière réserve de bois dans la région de Pont-Saint-Esprit ne soit complètement détruite.
En dehors des conséquences heureuses de l’Ordonnance de 1669 l’intervention de l’Etat n’a pas toujours été particulièrement favorable à la forêt.
D’après Kuhnholtz-Lordat, l’administration et le fisc ont joué un rôle constamment nocif et ont été en grande partie responsables (ils continuent à l’être encore aujourd’hui, attention au développement des carrières et à l’exploitation des gaz de schiste), des coupes abusives pratiquées dans la forêts gardoises. Déjà, par un mémoire du 7 novembre 1787, l’Intendant du Languedoc constatait que certains villages étaient obligés de trouver dans les coupes de bois le montant des impôts dont ils étaient redevables. Dans les départements méridionaux, la Marine, faute d’approvisionnements suffisants, était très exigeante et réquisitionnait tous les chênes ayant quelque peu de valeur. Il suffit de lire la requête présentée par la communauté de Tresques, le 28 mars I752, contre les fournisseurs du Roi, qui pour la cinquième fois viennent couper «des chaînes blancs » que « les particuliers ont épars dans leurs terres » et qui, forts de leur autorité terrorisent le pays avec une conscience assez élastique et peu scrupuleuse, « ils se gardent bien d’en faire couper à certaines personnes qui seraient capables de les faire mettre à la raison, ny à celles qui leur grècent la pate (sic)… »
L’incendie :
II est courant de réunir les deux problèmes de l’incendie et du pâturage; il est certain que le berger est à l’origine des nombreux incendies de la garrigue ou des Cévennes.
En 1924 M. Nègre écrivait dans un ouvrage intitulé : Les incendies de forêts dans les montagnes des Cévennes :
« …L’ennemi le plus redoutable de la forêt est le pâtre, qu’il soit simple berger salarié ou propriétaire de bêtes à laine. Si le berger met le feu par haine inconsciente de la forêt ou par insouciance, le propriétaire pratique l’écobuage à feu courant sur ses propriétés pour en faire disparaître momentanément genêts, bruyères, et autres mort-bois, et obtenir de l’herbe, le feu non surveillé gagne rapidement la forêt voisine ».
Lorsque, pendant des mois, la sécheresse a sévi et qu’en juillet et août, la lande ou la garrigue rougit sous le soleil, le berger, sans le moindre scrupule, met le feu pour qu’à la première pluie d’orage une herbe nouvelle rafraîchisse ses moutons oranais ou caussenards. La pratique est immémoriale, et il est inutile d’insister. Malgré les sanctions, malgré la diminution des troupeaux, cette coutume néfaste existe encore.
Toutefois le berger n’est plus aujourd’hui le seul responsable des nombreux incendies de la forêt méditerranéenne, quelques nouveaux incendiaires sont nés avec le progrès : le chasseur, le chemin de fer à une époque, le touriste, le pompier, le promeneur et bien d’autres encore…
Tous les forestiers qui ont respiré les parfums de la garrigue connaissent les déjeuners de famille dominicaux, à la fin du mois d’août ou pendant les septembre secs, interrompus brusquement par un feu de chêne vert. Les auteurs sont la plupart du temps inconnus, mais les incendies, pendant la période de chasse, commencent très souvent à une ou deux heures de l’après-midi, juste après la grillade traditionnelle de la saucisse que le chasseur gardois ne manque jamais d’emporter. Il serait certainement utile de repousser l’ouverture de la chasse au début du mois de septembre, pour la protection de la forêt.
L’agriculteur gardois, qui a hérité consciemment ou inconsciemment de cette pratique ancestrale des feux courants, n’éprouve pas toujours le besoin de se précipiter pour défendre la forêt contre l’incendie. Il faut qu’il y ait une ferme ou un hameau menacés pour qu’il soit convaincu de la nécessité de la lutte.
Ainsi, après des siècles d’écobuages, le paysage forestier est devenu peu à peu, par l’action répétée du feu, une garrigue à chênes kermès (plateaux calcaires) un maquis à bruyère à balais (collines siliceuses de l’Uzège), ou fourré à genêts (montagnes cévenoles).
Le pâturage:
Depuis un temps immémorial le plateau des garrigues, comme les montagnes des Cévennes, ont été parcourus par des troupeaux, principalement de bêtes à laine, J. REGIMBEAU en 1879 accusait le seul pâturage de la transformation de la forêt en garrigue. « Les bois appauvris qui restent encore sont le résultat de la lutte aveugle que l’homme et ses troupeaux ont engagée et poursuivent encore contre l’arbre » .
En 1842, Hector RIVOIRE estimait encore avec ses contemporains que la dépaissance était utile et nécessaire aux bois. C’est en fait l’abus de cette dépaissance qui fut néfaste. Il y a d’ailleurs lieu de distinguer entre les moutons et les chèvres. Les gros bestiaux et les porcs, bien que nombreux autrefois, ont joué un rôle de moindre importance.
Pour le mouton, le nombre a été le facteur le plus nocif. Alors qu’il n’est toléré actuellement que de 2 à 4 bêtes par hectare, les charges atteignaient 20 à 30 bêtes jusqu’au XIX° siècle. Il est intéressant de rappeler l’Arrêt du 15 octobre 1743, qui, pour favoriser l’élevage du mouton en Languedoc, faisait défense de tuer les agneaux pendant 5 ans, sous peine de 300 livres d’amende.
A Saint Marcel de Careiret, où il n’existe plus de troupeaux, il entrait en forêt communale de Cuègne (112 ha) au début du XIX° siècle :
Aujourd’hui, avec l’abandon des parcelles accidentées, trop petites ou trop étroites pour une agriculture mécanisée, les arbres ont repris une partie de leur territoire, notamment les pins dont la pousse est bien plus rapide que celle des chênes.
V.IX – VIE QUOTIDIENNE ET MORTALITE INFANTILE.
Jusqu’au 19ème siècle, l’indifférence entre la mère et le nourrisson semble être de règle dans les campagnes mais aussi chez les bourgeois et les nobles. Les enfants sont très nombreux il n’y a pas de moyen de contraceptions et les pratiques sexuelles sont très encadrées par la religion. Les « fantaisies » dans les pratiques sexuelles sont considérées comme des déviances et des péchés mortels.
La mortalité infantile est très élevée, et il y a un manque absolu d’hygiène.
De plus, il règne chez les paysans une grande misère matérielle et morale. On peut donc parler d’indifférence envers les enfants car il y a eu des abandons partiels ou totaux : les « bébés » restaient seuls à la maison pendant que les parents travaillent dans les champs (c’est à dire pendant plusieurs heures). Les bébés étaient langés, bandés et mis près du feu qui couvait pendant que les parents travaillaient : quand la mère rentrait chez elle, elle retrouvait son enfant dans un état déplorable ; « l’enfant baignait dans ses excréments », ou avait été brûlé vif par une braise sorti de la cheminée. On retrouvait donc des bébés brûlés, mangés par les porcs qui arrivaient à rentrer dans les logis : on appelait cela des accidents domestiques !
Quand la mère était présente, elle était loin d’être douce avec son enfant et pour le faire taire elle le secouait fortement (dans les berceaux de bois, il se cognait, dans les bras de sa mère il s’évanouissait) : on retrouve ces témoignages dans une quantité de textes de l’époque. Les femmes ne connaissaient pas l’âge exact de leur enfant. A 30 ou 40 ans, elles ne se souvenaient même pas combien elles avaient eu d’enfants (morts ou encore vivants !)
Face à la mort d’un enfant la famille donnait le même prénom au nouveau-né qu’à l’« ancien-mort » (l’enfant n’a pas d’identité… à lire « Un pédiatre raconte » de Samy Ramstein).
Quand il faisait froid et que toute la famille dormait dans le même lit pour se réchauffer l’enfant mourait étouffé. La mort du petit peut apparaître comme une bénédiction pour la famille : « une bouche de moins à nourrir ». Etant baptisé très jeune, l’enfant allait au paradis…
Au Moyen-Age, il y eut beaucoup d’infanticides (interdit en principe par l’église, mais tout le monde fermait les yeux). Il n’y avait aucune culpabilité à faire cela. Ces infanticides touchaient surtout :
-
-
- – Les enfants mal formés (malédiction divine).
-
- – Les enfants provenant de couples illégitimes (fruit du pêché).
-
- – Les jumeaux (les gens pensait à l’époque que les jumeaux provenaient de deux copulations et donc que la femme trompait son mari).
-
- – Les filles (pendant longtemps, les filles étaient inférieures au statut masculin). On ne se désole pas de la mort d’une fille dans les textes.
-
- – Raison économique : l’héritage se fait par les garçons, les filles, elles, ne recevaient rien.
-
Il y avait aussi des enfants abandonnés. L’abandon était considéré comme moins grave que l’infanticide. L’abandon apparaît comme une tradition culturelle, historique et Antique. On les abandonne dans la forêt puis au fur et à mesure on les laisse aux portes des églises et des abbayes.
L’apogée de l’indifférence des familles à l’égard de l’enfant peut prendre les formes suivantes:
-
- – Par abandon de l’enfant au fond des bois : c’est un meurtre simulé.
-
- – En laissant un enfant mal formé aux forains qui en font leur domestique ou des attractions de foires.
-
- – Par le système des Oblats : une famille ayant trop d’enfants, en confie quelque uns à des couvents. Le don d’un enfant à une institution est définitif. L’oblat est un cadeau fait à un monastère en guise de reconnaissance vis à vis de l’Eglise. Les enfants sont soumis à la dure règle des abbayes et couvents ; cérémonies religieuses, horaire et éducation stricte, froid, aucun droit d’amusements, quelques fois sévices sexuels. L’enfant est totalement consacré à l’Eglise et ne peut plus avoir de rapports avec sa famille.
Plus la situation générale est mauvaise et plus il y aura d’abandons : à cause de la famine et des épidémies les abandons augmentent encore.
Du 11ème au 13ème siècle :
C’est la période de prospérité, les méthodes agricoles progressent, il y a moins de misère. On assiste donc à une explosion démographique. Sur le plan juridique, on met au point la loi d’aînesse (le fils aîné reçoit tout l’héritage), ce qui abaisse le taux d’abandons des enfants car la crainte du morcellement des terres disparaît. Ainsi chez les pauvres et les riches, le nombre d’enfant augmente. Les pauvres peuvent aussi compter sur la charité des plus riches de cette époque, ainsi les pauvres abandonnent moins leurs enfants : cette aide est imposée aux familles les plus riches.
IL y a donc une explosion démographique : prohibition de l’infanticide par l’église, elle ne se contente plus de faire des menaces aux familles abandonnant leur enfant, elle agit : l’Eglise condamne ces abandons, les familles doivent se confesser et lors de confession sur les abandons d’enfants, le curé les condamne sévèrement.
Du 14ème au 18ème siècle :
Déclin de l’économie nationale, les richesses diminuent, les épidémies de pestes arrivent.
Ces facteurs influencent à nouveau les abandons d’enfants, de plus il n’y a pas de sanctions pour les enfants abandonnés issus d’adultère.
Ensuite, l’infanticide involontaire recule grâce notamment à l’interdiction de mettre le bébé dans le lit conjugal ce qui évite l’étouffement de l’enfant. En confession, quand le parent avoue avoir tué son enfant, les peines infligées par l’église sont extrêmement sévères par exemple : jeûne au pain et l’eau pendant un an ou plus. Dans les villes, si l’infanticide recule, les abandons augmentent : les églises vont alors ouvrir à partir du 13ème siècle des hospices, ce sont des institutions accueillant les enfants abandonnées : enfants légitimes abandonnés volontairement par manque d’argent pour les nourrir, et enfants illégitimes.
Au 17ème siècle, dans les hospices il y a l’apparition des tourniquets permettant le dépôt de bébés de façon anonyme. Il y a eu, en France 33 000 abandons d’enfants recensés plus tous ceux ignorés, pendant ce siècle.
Il n’empêche que la mortalité infantile reste élevée à cause du manque d’hygiène et de soins, du lait contaminé, des épidémies…
V.X – US ET COUTUMES, SUPERSTITIONS ET ABUS DES CROYANCES RELIGIEUSES.
On aura remarqué la puissance de l’église avant la révolution, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. Les autorités ecclésiastiques ont toujours su inventer et imposer des règles permettant de « tenir » les populations, des puissants aux plus humbles.
Ceci est vrai de tout temps, de tous pays et pour toutes religions.
Elles professent de bonnes règles de vie mais aussi de mauvaises.
On a vu que, par exemple dans notre région c’est l’évêque d’Uzès qui possédait tout et que les seigneurs locaux devaient lui rendre hommage à chaque succession, lui demander son accord pour vendre un bien et lui reverser une partie de la vente dudit bien, qui en définitive restait en sa possession en tant que suzerain.
Tous les actes juridiques, notariés et/ou reconnaissance commencent toujours par «Anno ab incarnationé Dominé …» ou «In Christi Jésus Dominé, amen … ».
Les sacrements de baptême, mariage et extrême onction, créés par le clergé, sont empreints d’une quasi superstition s’ils ne sont pas respectés et dans les temps et dans les formes.
Ainsi le baptême, en général, avait lieu dans les trois jours suivant la naissance en présence du père, de la sage-femme, des parrain(s) et marraine(s)… mais en l’absence de la mère.
En 1654, un évêque prévient les parents qui tardent à baptiser, du risque encouru :
« le péril de damnation auquel ils exposent leur propre enfant ». Il est dit aussi « Les enfants qui meurent sans recevoir le baptême ne peuvent aller au ciel. N’ayant pas commis de péchés personnels, ils ne sont pas soumis aux peines sensibles, ils ne brûlent pas dans le purgatoire ou dans l’enfer; mais ils vont dans les limbes. La perspective n’en est pas moins douloureuse et tragique; ils y subissent, en effet, la peine essentielle des damnés, qui est l’éternelle privation de la vue de Dieu. »
OK, très bien pourquoi pas ? Quoique … les millions et les millions d’humains nés avant JC doivent se bousculer dans les limbes !
Voici l’extrait d’un document vraiment particulier (âme sensible s’abstenir) :
Cela s’intitule : « Du soin extrême qu’on doit avoir du baptême des enfants dans le cas d’une fausse-couche ou de la mort d’une femme enceinte » il a été composé, imprimé, et distribué à Metz en 1764 par les soins de Jean-Martin Moye et de Louis Jobal de Pagny. Les deux responsables étaient inspirés par le Traité d’Embriologie sacrée, de Francesco Cangiamiglia, paru en 1745 en Sicile avec l’approbation de l’évêque de Catane.
« Si une femme enceinte meure il faut aussitôt l’ouvrir pour en tirer le fœtus de l’enfant et le baptiser. Et comme on ne sait pas en quel temps il est animé, car les uns disent à trente ou quarante jours, et maintenant les plus habiles médecins croient qu’il l’est à vingt, – il y a même des auteurs qui prétendent qu’il l’est aussitôt après la conception, – le parti le plus sûr serait de faire l’opération césarienne à toutes les femmes dont on a le moindre doute qu’elles soient enceintes ; et bien loin d’écouter les parents qui s’y opposeraient, on doit au contraire les forcer à y consentir en recourant au Magistrat. Il y a des évêques qui ont excommunié tous ceux qui voudraient empêcher cette œuvre de charité. On doit chercher exactement l’enfant, non seulement dans la place où il doit être naturellement, mais aussi partout ailleurs où il pourrait être, comme dans les endroits supérieurs à la matrice, et voir s’il y en a plusieurs. Il est aussi bon de savoir qu’il arrive qu’une femme accouche dans les travaux de l’agonie, et si on n’y prend garde l’enfant se trouvera étouffé dans le lit. On baptise ces sortes d’enfants par immersion, c’est-à-dire en les plongeant dans de l’eau un peu tiède. Si on doute s’il est vivant, ou si c’est un vrai embryon ou un enfant, on le baptise sous cette condition : « Si tu es capable de recevoir le baptême, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit « . Il faut que l’eau touche immédiatement l’enfant, sa tête ou sa poitrine ; ainsi on doit ôter la peau qui l’enveloppe, ou si on l’a baptisé sous cette peau ou membrane, comme on doit le faire lorsqu’il y a lieu de craindre qu’on ne fasse mourir l’enfant en l’ouvrant, il faut le rebaptiser ensuite sous condition après l’avoir ouverte ; de même si on avait baptisé dans le sein de la mère un enfant sur le bras ou sur le pied, ou avec un tuyau, ou avec la main en faisant couler l’eau sur lui, il faudrait le rebaptiser sur la tête sous condition.
On ne doit pas croire aisément que l’enfant soit mort, quoiqu’il ne donne pas signe de vie, et dans le doute on doit le baptiser sous condition. Pour distinguer si la production est un vrai embryon, ou seulement une mole ou un caillot de sang ou un faux germe, il faut le considérer avec attention, quand même le fœtus ne serait pas plus gros qu’un grain d’orge ou une fourmi. Si la membrane est d’une couleur tirant sur le blanc, semblable aux intestins, de figure ovale, et qu’elle cède à l’impression du doigt, on peut croire alors que c’est un fœtus et non une mole. Mais si ce qui est sorti du sein est une chair informe, marquetée de veines noirâtres et sanguines, et qu’elle soit rude et dure au toucher, on peut croire que ce n’est qu’une mole de chair et non un enfant, qu’on doit cependant toujours ouvrir avec précaution, car dans les fausses couches, les pertes de sang, les avortements et les opérations césariennes il faut avoir un très grand soin d’examiner avec toute l’attention possible tout ce qui sort du sein de la mère ; et il faut bien se garder de faire comme certaines sages-femmes imprudentes, qui les jettent indiscrètement sans examen ; et il y faut apporter d’autant plus de soin qu’il arrive que des femmes ont des fausses couches sans presque s’en apercevoir. J’ai été bien surpris, quand j’ai commencé à m’informer de la manière dont on se comportait dans ces fâcheuses circonstances, de voir que les premières personnes à qui je m’adressai pour cela avaient eu ce malheur, faute d’avoir été instruites sur tout cela. Je prie donc celles qui auront connaissance de cet écrit d’en faire part à toutes celles qui pourraient être dans le cas d’en faire usage. Et si quelqu’un peut avoir là-dessus une science plus étendue, il n’a qu’à voir le livre qui a pour titre, L’Embriologie sacrée. Benoît XIV (pape en 1740) l’a vu et estimé, et plusieurs évêques l’ont conseillé.(…)
Comme toute personne peut baptiser en cas de nécessité, même le père ou la mère de l’enfant s’il ne s’en trouve point d’autre qui puisse le faire, tout le monde doit savoir comment on doit baptiser. Il faut :
2° En même temps qu’on verse l’eau il faut prononcer ces paroles : » Je te baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit « . Toutes ces paroles sont si nécessaires que si on en omettait une seule le baptême ne serait pas valide.
3° Il faut que la même personne qui verse l’eau prononce les paroles, car si une autre les prononçait le baptême serait encore invalide.
4° Si on doute si l’enfant est vivant on ajoute : » Si tu es vivant, je te…, etc. « . Si on doute que ce soit un monstre, on ajoute : » Si tu es homme, je te…, etc. « . Dans ce cas on doit se garder de l’étouffer, mais on doit le faire examiner par des personnes sages et éclairées qui en décident.
5° Quand un enfant a été baptisé, mais qu’on doute si le baptême a été valide, comme s’il n’avait été baptisé que sur un membre différent de la tête, ou si l’on n’était pas sûr que l’eau l’ait touché, ou qu’on n’eût pas bien prononcé les paroles, ou enfin si on avait quelque autre raison de douter de la validité du baptême, il faudrait le rebaptiser sous condition, en disant : » Si tu n’es pas baptisé, je te baptise au nom…, etc. « . (…)»
V.XI – QUELQUES METIERS.
Il est difficile de retrouver les métiers pratiqués par les habitants du village au cours des siècles faute de documents écrits. On ne peut qu’imaginer ou comme j’aime à dire : supputer. Cependant, à la lecture des registres notamment des actes de mariages, les prieurs du village écrivaient quelquefois le métier du marié. Mais c’était souvent oublié, on préférait préciser si tel ou tel des époux était bien un fils légitime et naturel de ses parents, c’était à ces époques lointaines plus important !
J’ai donc trouvé à la lecture de ces actes, les métiers suivants, qui étaient ceux de jeunes hommes : berger, garçon maçon, cabaretier, boulanger, travailleur de terre, laboureur, vigneron, ménager, tisserand de toile ou simplement travailleur et même un, était chapelier à Goudargues.

Figure 149. Miniature du XIII° siècle, Paris, Bibliothèque nationale de France
Le berger
Les troupeaux étaient généralement gardés par des pâtres communaux, suivant contrats de garderie.
Tel ce bail de 17I9 pour la garde des porcs :
« Le berger est tenu de mener paître les porcs de six heures du matin à six heures du soir pendant la période du 1°avril au 1°octobre, et de neuf heures du matin à quatre heures du soir pendant la période du 1°octobre au 1°avril. Il est responsable des dommages causés aux tiers par les bêtes tout comme si les cochons lui appartenaient. De même, il doit payer les porcs qui meurent par sa faute, mais dès que le troupeau est ramené, il est déchargé de toute responsabilité. »
Son traitement était de 2 sols par tête et par mois, et tous les habitants étaient tenus de lui confier leurs porcs.
Vigneron
Les paysans plantaient sur leurs terres une rangée de ceps qui leur assuraient un peu de vin pour leur consommation personnelle. Mais quelques-uns, plus spécialisés, sont déjà mentionnés très tôt comme vignerons dans les registres paroissiaux.
La véritable année viticole ne commençait qu’en mars car on attendait la fin des gelées qui peuvent détruire les bourgeons jusqu’à la fin mai, pour tailler la vigne, une taille courte qui assurait la qualité en limitant la quantité, était faite à la serpette.
C’était aussi le moment où le vigneron remplaçait les plants morts, soit en prenant des plants enracinés tirés des pépinières, soit en provignant (marcottage), c’est-à-dire en couchant en terre un pied sain qui donnera trois ou quatre pieds nouveaux. Cette dernière méthode avait la préférence du vigneron car elle ne coûte rien, si ce n’est de la peine, et parce que le vigneron était persuadé que la vigne ne peut se soutenir et perdurer qu’en étant régulièrement provignée.
Ce faisant, l’aspect de la vigne se transformait rapidement. Plantée en ligne au moment de son établissement, elle devenait très vite une vigne en désordre car les pieds provignés partaient dans tous les sens. Cela serait un inconvénient si le vigneron utilisait une charrue pour entretenir sa vigne ; mais il n’a ni cheval ni charrue, et il pioche sa vigne à la main. Il faudra attendre les années 1880 pour voir apparaître les vignes bien alignées sur fil de fer.
Ces travaux de taille et de multiplication achevés, le vigneron donnait, de la fin mars à début avril, un premier labour.
Ce travail extrêmement pénible s’effectuait manuellement à la houe ; en l’espace de trois semaines, le vigneron piochait ainsi un à deux hectares de vigne, aérait la terre et détruisait les mauvaises herbes.
Début mai, le vigneron fichait les échalas, pieux de bois de chêne ou de châtaignier, longs d’1,50 m environ, destinés à soutenir la vigne et à maintenir les grappes éloignées du sol. Travail harassant encore, qui suppose le maniement de plusieurs dizaines de milliers d’échalas (il y avait environ 20 000 pieds de vigne par hectare) qu’il avait ôté de la vigne fin octobre et rapporté à la maison pour les épointer, et qu’il fallait maintenant transporter à nouveau dans la vigne.
Les échalas plantés, le vigneron donnait un second labour, plus léger, qu’il appelait le binage, et qui était terminé à la fin du mois de mai.
Puis la vigne fleurit, courant juin, les grains commencent à se former, le verjus grossit rapidement et avant la moisson des grains, le vigneron donnait un troisième labour : on dit qu’il rebine ou encore qu’il tierce pour débarrasser la vigne des mauvaises herbes.
Si la saison était très humide un quatrième labour pouvait être nécessaire en septembre, avant les vendanges, pour permettre une maturation plus parfaite des raisins.
Si la vigne avait été épargnée par les maladies et la grêle, le vigneron vendangeait fin septembre ou début octobre.
Coupeurs et hotteurs parcouraient alors la vigne. Les coupeurs, serpette à la main (le sécateur apparaît en 1840 et se généralise tardivement), emplissaient les paniers et les vidaient dans leurs hottes. Les hotteurs emplissent alors de grandes hottes placées sur le dos des ânes, ou des cuves plus grandes transportées dans des charrettes en direction du cellier ou du pressoir.

Figure 150. Numérisation de l’Auteur. Collection personnelle.
Laboureur
Ils sont considérés comme des notables des campagnes, très présents dans les assemblées villageoises et, parfois, interlocuteurs directs du seigneur du lieu. Certains sont relativement riches, d’autres moins, mais ils représentent néanmoins l’élite villageoise, les plus favorisés s’appelaient des ménagers. De leurs terres ils parviennent à tirer la subsistance de leur famille quelle que soit la conjoncture climatique ou économique. La plupart sont des fermiers qui possèdent un ou plusieurs terrains de culture, du bétail, des semences et du fourrage. Ils louent des superficies importantes au seigneur, qu’ils pourront mettre en valeur grâce à leur capital d’exploitation.
Avant la révolution, l’épandage du fumier dans les champs était rare, du fait du nombre restreint de vaches dans chaque famille. Pour pallier à cette déficience, il fallait faire plusieurs labours dans l’année (environ quatre), c’est la raison pour laquelle celui qui possédait un araire ou une charrue avec un attelage de trait était sollicité par ceux qui n’avait rien de tel. Il est difficile d’imaginer ce que pouvait être un champ de blé au XVIIIème siècle : un champ envahi de mauvaises herbes, des épis courts, ne portant que quelques grains, et des grains dont l’enveloppe est ridée, montrant un déficit de croissance, d’où, des rendements faibles.
En bref, être laboureur était le passage obligé pour celui qui, parti de rien, voulait gravir l’échelle sociale.
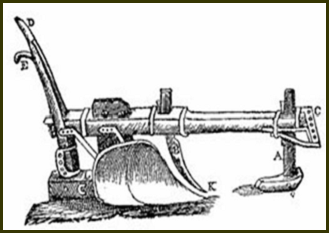

Figure 151. L’araire et la charrue. Numérisation de l’Auteur. Collection personnelle.
Du lever au coucher du soleil, le cultivateur travaille avec la terre, mais également vit avec elle, au rythme des saisons et des évolutions qu’elle dessine. Il doit comprendre ses attentes et faire face à ses caprices. Son métier est soumis aux aléas du climat.
Il faut labourer, herser, semer les blés d’automne, récolter les dérobées, panser les bêtes tout l’hiver, semer les blés de printemps, les biner, récolter les foins, moissonner, semer et sarcler les dérobées, battre la moisson, couper les regains, etc. A ces tâches que le cultivateur ne peut pas différer, s’ajoutent les tâches d’entretien du matériel et des bâtiments, la fabrication des outils, etc. En plus, quelle que soit la taille de l’exploitation, le cultivateur n’a pas droit à l’erreur car le moindre pari incertain sur l’avenir peut entraîner de lourdes conséquences.
Il doit savoir tout faire de la forge à la charpente.
Les paysans ne se préoccupent le plus souvent que de leur subsistance; ils restent isolés et ils ne sortent de leurs villages que pour le marché du bourg voisin.

Figure 152. Laboureur. Encyclopédie Diderot d’Alembert 1751-1772
Journalier ou travailleur.
La catégorie de paysans moins favorisée est celle des travailleurs de terre, ne possédant que de très petits lopins et bien sûr pas de cheval, seulement un âne ou une mule (ou mulet) dans le meilleur des cas.
La dernière catégorie et les plus pauvres, parmi la population rurale active, sont ceux qui louent, au jour le jour, leurs services, leurs forces et ne disposent que de leurs bras, leurs mains. On les désigne donc comme des « journaliers », des « manouvriers », ou tout simplement des « travailleurs » etc.
Un journalier est engagé pour un travail généralement agricole rémunéré à la journée. Il était susceptible de pouvoir cultiver un journal de terre (environ une acre).

Figure 153. Miniature du XIII° siècle, Paris, Bibliothèque nationale de France
L’unité de surface travaillée portait également le nom de « jour » pour les champs labourés, de « faux » ou « fauchée » pour les prés, d’ « ouvrée » pour le bêchage de la vigne.
Ne possédant rien d’autre que sa force et ses bras, il était le niveau le plus bas dans l’échelle des métiers de la terre.
Producteur d’huile de cade
Les fours à cade qu’on trouve encore dans la garrigue rappellent l’époque où cette huile était produite directement dans les champs : là où poussait le genévrier cade, on construisait de grands fours cylindriques en pierre, le bois y était lentement consumé et on récupérait l’huile dans la partie basse du four. Leur utilisation a cessé pendant la seconde guerre mondiale ; les distilleries modernes ont supplanté ces méthodes artisanales.
Cette huile appelée l’huile empyreumatique était utilisée autrefois pour ses vertus cicatrisantes, toujours très appréciée comme antiseptique et désinfectant. Elle est fréquemment associée à divers produits tels que les shampooings. Elle constitue un traitement local d’appoint du psoriasis et des dermites séborrhéiques. Elle sert aussi à soigner les sabots des chevaux. Elle entre dans la composition de l’onguent de maréchal ferrant. Frédéric Mistral y fait allusion dans le Trésor du Félibrige en parlant d’une huile âpre dont les bergers se servent contre la gale. Elle est très efficace dans l’éloignement des rongeurs, ainsi que comme répulsif d’insectes.
Cependant elle ne sent pas très bon et il faut éviter de l’employer « pure » sur la peau. Les facteurs de flûte à bec s’en servent afin de fabriquer le bouchon du bec de la flûte.
C’est aussi un excellent antimite. On l’utilisait autrefois dans le Gers pour éviter que les canards ne s’attaquent entre eux en mettant quelques gouttes sur leur croupion.

Figure 154. Les fours à cade. Photo de l’auteur.
Cabaretier
Ce corps de métier remonte à 1587 lorsque le roi Henri III donna des règlements communs aux marchands de vin, aux taverniers, aux cabaretiers, et aux hôteliers. A la différence des taverniers qui ne pouvaient vendre que du vin à emporter, les cabaretiers pouvaient vendre le vin au détail mais aussi donner à manger. Pour être cabaretier, il fallait être catholique romain. Ils ne devaient recevoir personne chez eux le dimanche pendant les offices et les trois derniers jours de la semaine sainte.
Les officiers de police visitaient les boutiques pour s’assurer de l’exécution de ces règlements. Les contrevenants étaient passibles de fortes amendes voire de peines corporelles lors de récidive. Les cabaretiers étaient très nombreux au XIX ème siècle. Dans les villes, on en dénombrait en moyenne un pour 50 habitants.
Les fautes majeures pour lesquelles pouvaient être punis ces débitants de vin sont :
– tenir maison ouverte à l’heure du service divin,
– tolérer les jeux de hasard et les blasphèmes,
– donner asile aux vagabonds, larrons et gens mal famés,
– servir des vins souillés ou mêlés.
Tonnelier
Le tonnelier est un artisan qui, avec une grande précision, fabrique ou répare, par des moyens traditionnels, des futailles étanches de toutes formes et de toutes dimensions, les tonneaux comme les cuves ou les foudres.
Son coup de main et son coup d’œil feront la bonne barrique qui permettra le vieillissement du vin ou de l’alcool.
Le principal matériau utilisé est le bois de chêne, fendu en merrains par le mérandier dans les forêts.
Le tonnelier n’utilise guère de machines, il fend le bois vert du chêne ou du châtaignier, dans le sens des fibres. Il lui donne sa forme définitive sur la colombe puis à l’essette, que lorsqu’il est devenu sec, il peut en se gonflant sous l’humidité assurer des joints étanches.
Il construit d’énormes foudres bardés d’échafaudages où vieillissent les cognacs, des fûts et des tonneaux ou d’élégants tonnelets de fantaisie, vernis, ciselés et cerclés de cuivre. Le tonnelier utilise également des cercles de bois entourés d’osier, ou plus récemment des cercles de fers.
La première étape de la fabrication est le dolage qui consiste en la préparation des douelles qui serviront à fabriquer le tonneau.
Vient ensuite l’assemblage ou bâtissage : le tonnelier réunit les douelles en tronc de cône, ceinturées à l’extrémité supérieure par un cercle provisoire. Ensuite, un deuxième cercle est enfoncé à mi-hauteur. Lorsque la barrique a pris forme, elle est mouillée et un feu de copeaux est allumé à l’intérieur. Quelques heures plus tard, à l’aide du bâtissoir ou botissoire, le tonnelier resserre les douelles à l’autre extrémité et met en place un troisième cercle.

Figure 155. Numérisation de l’Auteur. Collection personnelle.
Charpentier
Le métier de charpentier est un travail d’équipe qui impose un travail en extérieur sur des ouvrages souvent impressionnants. Le charpentier doit calculer très précisément ses assemblages, il doit penser son travail à l’avance.
En plus des charpentes il réalise les échafaudages et pour la fabrication des voûtes pour un grand bâtiment, comme le château ou lors de la réalisation du pont il réalise les berceaux à voûter, véritable construction en négatif de ce que sera l’ouvrage fini, sur laquelle repose les pierres taillées de la voûte.
Il faut d’abord choisir le bois, essentiellement du chêne ou du peuplier puis tracer l’épure au sol, faire les pièces qui sont numérotées puis assemblées.
Le montage est un travail de force et de précision. A cheval sur les échafaudages les charpentiers sont de vrais acrobates. Ils assemblent de grosses poutres de bois qui forment l’ossature de l’édifice.
Dès que la charpente est terminée, ils ont l’habitude d’y accrocher un bouquet de fleurs.

Figure 156. Numérisation de l’Auteur. Collection personnelle.
Le Charron
L’apprentissage commençait vers l’âge de 14-15 ans, suivi de 4 années de compagnonnage et de nombreuses années de pratique.
La tâche principale du charron est de faire des voitures en bois de tous gabarits : carrioles, tombereaux, charrettes suivant les charges à véhiculer et l’état des chemins.
Dans chaque village, il y avait un charron. Le travail ne manquait pas à l’époque, il fallait des chevaux pour tirer la charrue, tracter brabants, charrettes et autres véhicules en bois.
Le charron travaillait souvent avec le forgeron pour le ferrage des roues. Les commandes pouvaient également être passées pour des échelles, mangeoires, râteliers, brouettes et tonneaux.
En hiver, le charron s’occupait de rentrer son bois et dès les beaux jours, les commandes affluaient, pour préparer le matériel utile aux moissons.

Figure 157. Numérisation de l’Auteur. Collection personnelle.
Maréchal-ferrant.
Le ferrage des chevaux est apparu en France vers l’an 500.
Il est fort probable que cette invention fut longue à se propager dans toute la France et surtout dans le monde paysan, ou l’usage des chevaux dans l’agriculture était rare, et l’usage du ferrage des bovins tout autant. En fait dans la nature les chevaux n’ont pas besoin de fer, la corne du sabot poussant de manière constante à raison de près d’un centimètre par mois. Mais les chevaux utilisés dans les champs et plus encore ceux qui servent aux transports des personnes et des biens sur les routes, voit l’usure des sabots se faire plus rapidement que le remplacement naturel. Le ferrage des chevaux devient indispensable sinon celui-ci doit être inemployé le temps que la corne se refasse. Mais à l’inverse, comme la corne continue à pousser, il faut régulièrement remplacer les fers, les pointes le fixant, se trouvant dans les parties fragilisées et anciennes du sabot, c’est aussi pour cela que les fers étaient régulièrement perdus par les animaux.
En plus de ferrer les chevaux, les mules et les vaches, le maréchal fabrique et répare les versoirs et les pièces en fer des charrues, des attelages, tout l’outillage à main nécessaire aux travaux des champs et les outils des artisans du village. Il forge également les objets de la vie domestique, en particulier ceux qui servent à la cuisine dans l’âtre : crémaillères, landiers, trépieds et grils…
Le maréchal-ferrant n’est pourtant pas riche. Jusqu’au début du XXème siècle, c’est le troc qui prévaut : le meunier le paie en farine, le fermier en volailles, légumes, grains ou bois de chauffage, d’autres encore troquent leur travail contre celui du maréchal… S’il y a un paiement en numéraire, il se fait deux fois par an, notamment à la Saint Éloi et à Noël.
Le maréchal et ses apprentis portent un tablier de cuir à poche, retenu sur les cuisses par des courroies et des boucles de métal en forme de cheval ou de cavalier. La prise du tablier est un rite qui se déroule au cabaret. L’envers du tablier du nouveau forgeron est marqué de l’empreinte d’un verre de vin ou d’une pièce de monnaie et de la signature de ses camarades : c’est la tradition.

Figure 158. Numérisation de l’Auteur. Collection personnelle.
Le Potier.
L’idée de façonner la terre ne date pas d’hier et le potier, « homme de la terre » s’il en est, reste l’un des plus vieux artisans de notre civilisation.
Utilisées depuis toujours pour la cuisson des aliments ou au service de l’eau, les poteries deviennent alors objets de décoration ou même d’art. Le potier est doublement homme de la terre : il la façonne et il la cultive. Sauf pour les plus grands centres, il est aussi un cultivateur qui retourne à son champ et à sa vigne si son activité d’artisan n’est plus suffisamment rentable. Inversement, des paysans deviennent artisans par leur mariage avec la fille d’un potier, bien que les alliances se fassent en général entre familles de la même corporation.
La situation sociale du potier est très variable selon sa place dans la hiérarchie du métier, la région et l’importance des ateliers. Au XVIIIème siècle, des maîtres potiers-laboureurs propriétaires de leurs ateliers sont des gens aisés, qui savent lire, écrire et compter. En revanche, les maîtres potiers-métayers qui doivent céder à leur propriétaire la moitié de leur production sont souvent aussi pauvres que des ouvriers.
Le tourneur est le plus qualifié, le plus apprécié et le mieux payé des ouvriers. Le tournage est l’apanage des hommes. Les femmes et les filles des potiers sont cantonnées dans des besognes annexes et mal rétribuées, telles la pose des anses et les finitions. Il est propriétaire de son tour et travaille avec un manœuvre et une finisseuse qu’il paye sur son salaire. Il est rémunéré à la pièce, au compte (un ensemble de pots) ou à la journée.

Figure 159. Numérisation de l’Auteur. Collection personnelle.
Chapelier.
Un chapelier fabrique des chapeaux, non pas à la chaîne, mais selon des méthodes artisanales. La conception d’un chapeau passe par plusieurs étapes et peut nécessiter des dizaines d’heures de travail, pour les chapeaux les plus complexes.
Tout d’abord, il y a la phase de création où l’imagination a une place importante pour créer un produit qui pourra satisfaire les besoins d’un client ou d’une élégante.
La seconde étape consiste à mouler les chapeaux sur des supports en bois sur lesquels on applique les feutres et les pailles pour donner une forme à la matière.
La dernière étape, quant à elle, repose sur la finition où l’on peut appliquer des tissus, des voilettes ou même des fleurs pour garnir le chapeau. Le chapelier peut également travailler avec des fleuristes pour parfaire sa création.
Moulinier
Autrefois on plongeait les cocons dans l’eau chaude pour dévider le fil de soie.
Le fil passait ensuite à la dévideuse pour dérouler le cocon afin d’en tirer le fil de soie et la dévideuse réunissait plusieurs fils, de quatre à dix selon la grosseur du fil désirée. Le moulinier intervient à ce stade en permettant de rendre le fil de soie utilisable pour le tissage.
Le moulinage consiste à tordre ensemble plusieurs fils de soie pour plus de solidité. Plus le fil est tordu, plus l’étoffe sera souple.
Ensuite, on faisait bouillir les écheveaux avec un dissolvant afin d’éliminer les dernières traces de grès, matière qui entoure le fil de soie.
Le fil est ensuite imprégné d’alun afin de pouvoir recevoir la teinture avant d’être tissé sur les métiers à bras. Le marchand moulinier faisait commerce des écheveaux de soie qu’il avait patiemment tordus.
Nous avons vu au chapitre précédant qu’en 1842, Hector RIVOIRE identifiait 4 filatures de soie à St André d’Olérargues.
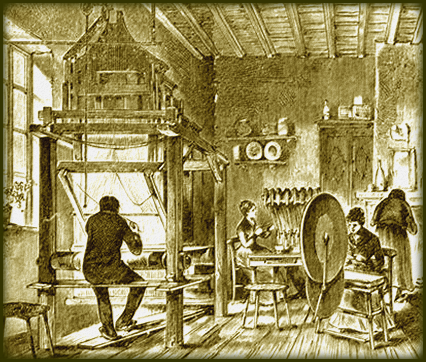
Figure 160. Numérisation de l’Auteur. Collection personnelle.
Quelques autres métiers
Il y avait aussi un tas de métier qui certains se faisaient à plein temps ou en complément du travail de la terre comme les Bouscatiers qui coupaient puis brûlaient le bois pour livrer les villes en charbon de bois, les chaufourniers qui construisaient des fours à chaux dans lesquels ils brûlaient le calcaire, les ruscaïres (écorceurs) qui prélevaient plusieurs types d’écorces à destination des tanneurs pour traiter les peaux etc.
V.XII – QUELQUES ACTES ECRITS DE LA VIE QUOTIDIENNE
Il y a dans les archives paroissiales quelques registres d’état civil (enregistrement des baptêmes, mariages et décès) qui ont été conservés. Beaucoup manquent, soit ils n’ont pas été tenus à jour soit ils ont été égarés.
Ci-après quelques exemples.
Un des premiers que nous ayons date de 1685, c’était pendant le règne de Louis XIV. Cela fait à ce jour 328 ans !
Le registre était alors tenu par le prieur de la paroisse qui s’appelait à cette époque Camerle. J’en reparlerai plus loin. Le chanoine Roman dans sa monographie sur St André d’Olérargues de 1901, précise que le ministère du prieur Camerle a duré de 1687 à 1692, or à la lecture des registres on constate qu’il les tenait déjà en 1685 et les tenait encore en 1698.
Voici le fac-similé de la page du registre du mois de novembre 1685. On peut y lire avec quelques difficultés :
Dans la marge : Bapt Baptiste Ponsonnet
Le texte : L’an mil six cent quatre-vingt-cinq et le (dix-neuvième) du mois de novembre Baptiste Ponsonnet a été enterré dans le cimetière de St André d’Olleyrargues présents André Beillesse (… ?) et Jean (… ?) Camerle prieur de St André
Ce qui signifie qu’il a été baptisé et enterré le même jour.
Dans la marge : Bapt André Flandrin
Le texte : L’an mil six cent quatre-vingt-cinq et le dix-huit novembre a été baptisé André Flandrin fils naturel et légitime de (… ?) Flandrin ménager et de Gabrielle Laville. Son parrain Antoine Lauron sa marraine Claude Beillesse présents André Beillesse (… ?) et Jean (… ?) .Camerle prieur de St André
Dans la marge : Bapt Marie André Le texte : L’an mil six cent quatre-vingt-cinq et le vingt-deux novembre dans la paroisse de St André d’Olleyrargues a été baptisé Marie André fille naturelle et légitime de Pierre André et de Gabrielle Croisite. Son parrain Louis Marcor, sa marraine Marie Ode présents Jean Beillesse et Jacques Ode illettré. Camerle prieur de St André
On remarquera, comme ci-dessus, qu’il est souvent précisé dans les documents officiels : «untel illettré » ou « untel sachant lire ». C’était une marque de culture et de compréhension.
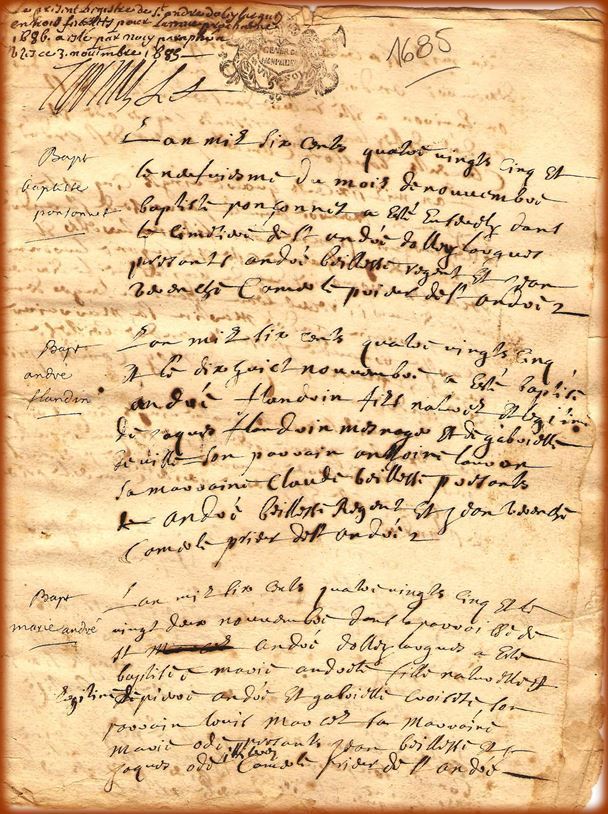
Figure 161. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Après la révolution les registres sont tenus avec plus de rigueur. La notion de maire n’est pas encore clairement établie. C’est l’agent national de la commune d’Oleyrargues qui la représente. Ainsi on peut lire concernant l’année 1794 (Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793) l’extrait des décès suivant :
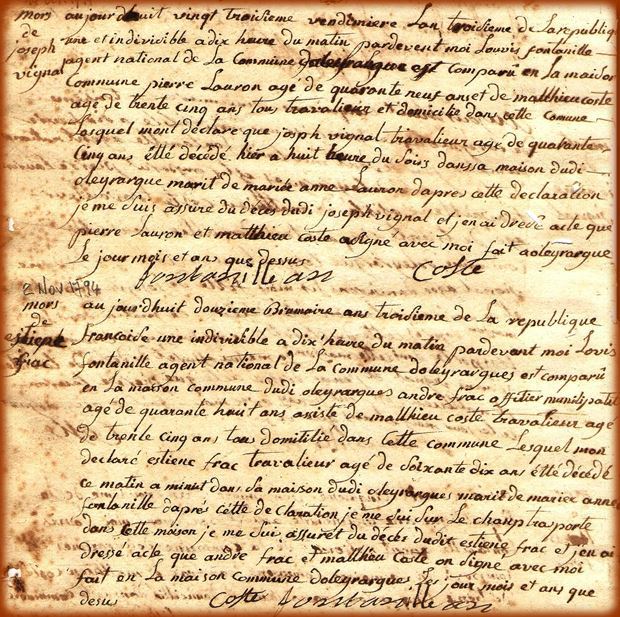
Figure 162. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Cette page est assez bien écrite et lisible, à remarquer les quelques fautes d’orthographe intéressantes…
Concession de lignite de St André d’Olérargues.
Cette concession accordée par ordonnance royale de Louis-Philippe du 29 mars 1847 au sieur Joseph-Louis-Auguste Cotton. Les limites décrites dans l’extrait du journal officiel reproduit ci-après renferment une étendue superficielle de 53 hectares.
« Article 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de St André d’Olérargues, est limitée, conformément au plan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu’il suit, savoir :
-
- Au nord et à l’ouest, par une ligne partant du point B, borne limitrophe des communes de St Marcel et de St André d’Olérargues et menée jusqu’au point C, grange du sieur Jean Vignal ;
-
- Au nord et à l’est, par une ligne droite, allant du point C au point D, grange du sieur Vallalery ;
- Au sud par une première ligne droite, menée du point D au point E, bergerie de la veuve Brun de Careiret ; puis une seconde ligne dirigé de ce point E au point de départ B
Article 4.
-
- Les droit attribués axu propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une retribution annuelle de dix centimse par hectare.
- Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. »
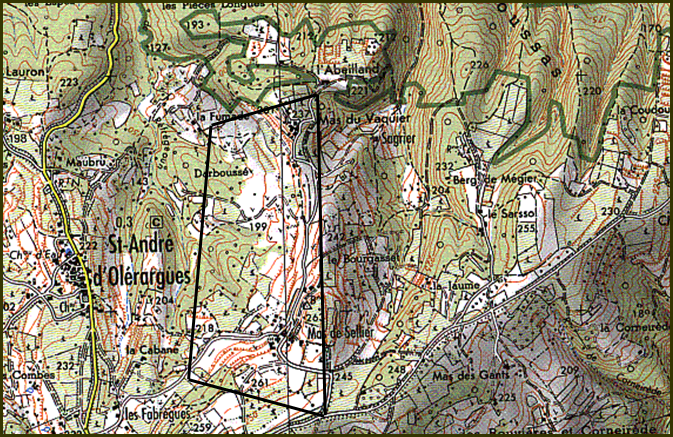
Figure 163. Numérisation de l’Auteur. Carte IGN.
Cette concession est peu importante : on n’y a reconnu que six couches de combustible, dont une seule exploitée à 0.375 m d’épaisseur. Les cinq autres n’ont que 0.250 m d’épaisseur et sont par conséquent à peu près inexploitables.
Le toit ou garde de la couche exploitée est calcaire et très solide, il a de 1.125 à 1.250 m d’épaisseur. On en extrait de belles dalles très régulières employées pour réaliser des marches d’escalier, qui sont pratiquement indestructibles.
L’exploitation du gisement de lignite est très limitée : le mauvais état des chemins rend le débit presque nul. La vente annuelle en 1850 n’est que de 1 200 quintaux à 0.35 F le quintal.
Il s’en consomme à peu près 1 000 autres quintaux pour la fabrication de chaux à partir des calcaires extraits dans cet étage à lignite que l’on cuit sur les lieux même de l’extraction du combustible pendant une partie de l’année. Cette chaux est grasse, pour en obtenir 100 quintaux on brûle environ 80 quintaux de lignite. Ce four peut livrer annuellement de 12 à 1500 quintaux à la consommation.
Ces mines sont affermées par le concessionnaire aux nommés Ponsonnet et Pierre Mazon, moyennant 300 quintaux de lignite qu’ils lui livrent annuellement sur place, et de plus, charge à eux d’acquitter les droits de redevance annuelle qui s’élèvent à 63 F et 25 F pour droit de la surface dû aux propriétaires du fond.
En 1965 il est publié au journal officiel :
« Les mines de lignite de Saint André d‘Olérargues, appartenant à l’Etat, sont replacées dans la situation de gisement ouvert aux recherches et, en conséquence, la concession initiale correspondante est annulée. » (Arrêté du 9 mars 1961, JO)
Concession de lignite de St Marcel de Careiret.
Cette concession a été accordée aux titulaire par un décret du président de la république, Bonaparte futur Napoléon III, daté du 1° décembre 1851, sur la demande qu’en avait faite, le 27 octobre 1846, les sieurs Jean Baptiste Vincent, propriétaire et maire de St Marcel de Careiret ; Jean Serre, propriétaire en la même commune et Alexis Bouletin, ancien exploitant des mines du Pin. Cette concession, comprise en entier dans la commune de St Marcel, est délimitée ainsi qu’il suit :
Au nord, par une ligne droite allant du clocher de St Marcel à l’angle nord du château des Opiats, cette ligne étant prolongée jusqu’à son intersection avec la limite des communes de St Marcel et de Verfeuil.
- A l’ouest, par une ligne droite menée de ce dernier point à l’intersection du chemin de St Marcel à Valsauve, avec la limite des communes de St Marcel et de Verfeuil.
- Au sud, par la ligne droite menée du point précédent à l’angle sud de la grange des Six Deniers.
A l’est, par une ligne droite menée de l’angle sud de la grange des Six Deniers au clocher de St Marcel de Careiret point de départ.
Les dites limites renferment une superficie de 48 hectares.
Quand on suit le vallat de Cuègne depuis son origine, à un kilomètre environ au sud-ouest de St Marcel de Careiret, jusqu’au-dessous du château des Opiats on rencontre un grand nombre d’affleurement de lignite dont plusieurs ont été anciennement fouillés. Malheureusement ces couches de combustible sont d’une faible épaisseur.
Un rapport du BRGM portant sur des travaux sécuritaires à réaliser sur la concession minière orpheline de St Marcel de Careiret concédée pour l’exploitation de lignite, nous renseigne sur sa localisation précise et son importance. Les travaux d’exploitation ont essentiellement porté sur des affleurements et par galerie avec un travers banc (galerie de liaison entre les puits) de 200 mètres (Rapport BRGM R 37912). Le tonnage moyen annuel extrait est estimé à 682 tonnes de lignite, essentiellement entre 1852 et 1868. La mine a été ensuite abandonnée jusqu’en 1917 où ont eu lieu quelques travaux de reconnaissance, de même qu’en 1935 pour vérifier si le gisement pouvait être encore, d’une exploitation rentable.
Carte représentant approximativement la localisation de la concession.
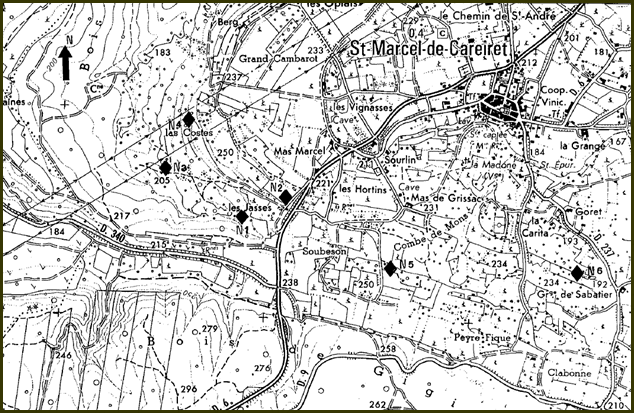
Figure 164. Carte de situation des anciens ouvrages miniers. Rapport BRGM R39295
V.XIV – HISTOIRE DE LA MINE
ET DU CHEMIN OUBLIE.
Il est un lieu sur la commune de St André d’Olérargues que tous les chasseurs de sangliers et quelques promeneurs connaissent sous le nom de « La Mine » le chemin qui y mène est lui, connu sous l’appellation de « chemin de la mine ».
C’est quoi cette mine ?
Avant de parler de la mine, il nous faut parler du chemin et plus généralement des chemins. Les premières voies de communication pouvaient être soit un sentier, plus ou moins escarpé et raide permettant de se rendre d’un point à un autre le plus directement possible, souvent à pied ou avec un animal faiblement chargé. Soit un chemin de plus grande circulation permettant le passage d’une charrette ou d’une carriole tractée par un animal de trait.
Dans ce deuxième cas la pente du chemin doit être relativement faible de l’ordre de 5% maximum, car il est très difficile pour un animal de tracter une charge en montée notamment avec des véhicules à roues pleines, en bois ou même avec un bandage métallique.
Nous voyons sur la carte ci-après que pour les exploitants des mas qui voulaient descendre vers Goudargues par exemple, pour vendre ou acheter des produits sur les marchés, il était difficile de rejoindre la route du mas Blanquet pour aller d’un côté vers Bagnols ou de l’autre vers Verfeuil et Goudargues via Clapeyret.

Figure 165. Numérisation de l’Auteur. Carte IGN
Il existait un chemin. Il existe toujours partiellement. Nous allons le suivre sur la carte ci-dessus en le remontant depuis la route du mas blanquet. Il rejoint la route au niveau du D de Darboussas sur la carte, il rejoint le Vallat du Layac, il le remonte en suivant la rive droite.
Il coupe une première fois le cours du ruisseau et suit alors la rive gauche, il croise ensuite un sentier assez raide qui va vers l’Abeilland et remonte, en pente raide sur des dalles de pierres affleurantes, vers le mas Vaquier. C’est là qu’apparait le lieudit « la Mine » et que le chemin disparait. Mais en réalité il n’y a pas de mine, c’est un pont que enjambe le ruisseau. Un ouvrage de pierre, en voute plein cintre de dix mètres de long. Il avait pour but de refranchir le Layac pour continuer à monter en pente douce de long de la rive droite.
Si l’on traverse ce pont dont la partie centrale est effondrée, on retrouve nettement la trace du chemin, dont la largeur permettait un trafic aisé de charrettes. C’est sans doute cet effondrement qui a stoppé l’utilisation de cette voie. Quand on voit la taille et le travail réalisé sur l’ouvrage, on comprend qu’il a été fait pour une circulation importante. Si ce passage avait seulement servi aux troupeaux ou au débardage du bois, un gué aurait suffi. Aujourd’hui le vallat du Layac ne coule guère bien qu’en amont il y a encore quelques jolis trous d’eau et qu’en aval le cours est presque régulier et continu si la sécheresse ne sévit pas trop.
J’ai dit plus haut que le chemin enjambait deux fois le ruisseau, le premier pont est tout aussi important. Entre les deux ponts, sur la rive droite il y a un ancien lavoir, ce qui tendrait à prouver que ces lieux étaient fréquentés.

Figure 166. Photo de l’auteur
A ce niveau un sentier de chasseur, assez raide, monte sur la gauche à peu près où sur la carte il est écrit Sagrier (qui doit être une faute de retranscription, car un dénommé Jean Sagnier habitait là en 1768).
Ce sentier rejoint un chemin qui sur la droite rejoignait le chemin du pont que nous venons d’abandonner pour prendre le sentier montant.
On voit bien sur la carte le pointillé du chemin enfoui dans la végétation, qui continue à longer le ruisseau pour rejoindre à peu près à l’altitude 204 m le chemin dont j’ai parlé et où aboutit le sentier de chasseur. Lequel chemin monte en pente douce, contourne par la droite la bergerie de Mégier et revient vers Sarsol et la route de Christol.
Ainsi de la route du mas Blanquet jusqu’à la route de Christol la montée était progressive et praticable par des animaux de trait lourdement chargés.
Beaucoup de personne appelle « la mine » le tunnel du pont qui est partiellement effondré.
Dans la même zone, un peu en aval de ce pont, entre ruisseau et chemin il y a ceci :

Figure 166-1. Photo de l’auteur
Qu’est-ce ? Une entrée de mine partiellement comblée ? Autre chose ?
A l’intérieur c’est ainsi :

Figure 166-2. Photo de l’auteur
On y retrouve le même type de construction que dans la galerie de la Font de Vendras : galerie rectiligne, cotés en pierres bien empilées et plafond en grandes dalles de pierre.
Cette galerie est orientée perpendiculaire au chemin et, est effondrée un peu avant de passer sous ce chemin.

Figure 166-3. Photo de l’auteur
Elle débouche ensuite dans un fossé de collecte des eaux longeant le chemin à gauche en descendant.
Finalement cette construction permet lors de gros orages de collecter les eaux descendant de l’Abeillaud, évitant ainsi, d’emporter à la longue le chemin. L’eau passe par cette galerie et va se déverser directement dans le ruisseau du Layac. Ce n’est toujours pas une mine. Pépé (c’est mon chien) a été voir … RAS ici m’a-t-il dit …

Figure 166-4. Photo de l’auteur
J’ai continué à chercher.
Sur les indications de plusieurs personnes j’ai fini par trouver « le trou de la mine » c’est une cavité verticale d’environ 4,5 mètres de diamètre et d’une dizaine de mètres de profondeur.
Il est situé au milieu des bois, dans une zone peu fréquentée et difficile d’accès et de localisation. Il est creusé dans l’étage géologique Turonien C3.
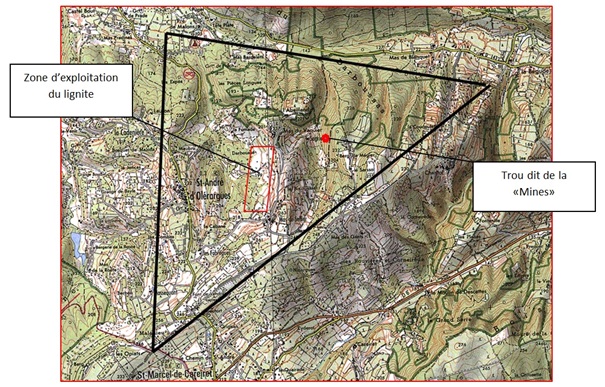
Figure 166-5. Photo de l’auteur
Les questions que l’on peut se poser sont quelle est son origine (datation) et si c’est une réalisation humaine quelle a été son utilité ?

Figure 166-6. Trou de la mine dans la végétation. Photo de l’auteur
Figure 166-7. Photo de l’auteur
Figure 166-8. Vue de dessus de la cavité. Photo de l’auteur
Quatre hypothèses possibles entre autres.
1° hypothèse : c’est une cavité naturelle de type aven.
Cette supposition ne tient pas car les cavités naturelles se creusent dans les terrains karstiques et l’étage Turonien C3 n’est pas un terrain karstique.
2° hypothèse : Cette cavité a un rapport avec l’exploitation minière du lignite qui a été faite sur la commune au 19° siècle.
L’exploitation du lignite s’est faite par une extraction à ciel ouvert et à flanc de collines avec de petites galeries horizontales et dans l’étage géologique Paulétien C2.
L’hypothèse serait que cette cavité ait été créée pour faire une prospection afin d’atteindre le niveau à lignite par un puits.
Cette supposition ne tient pas non plus car si on regarde une coupe du terrain dans cette zone, on se rend compte que pour atteindre l’étage à lignite il faudrait creuser plus de 200 m de profondeur.
Figure 166-9.Localisation du « trou de la mine » par rapport à l’étage stratigraphique du lignite. Photo de l’auteur
3° hypothèse : C’est une mine Néolithique d’exploitation du silex.
C’est au cours du Néolithique, surtout à partir de 4500 ans avant notre ère, que vont apparaître un peu partout à travers l’Europe des mines d’extraction du silex.
Ces mines de silex vont perdurer jusqu’à l’apparition d’outils en métal. En Europe du nord, les dernières mines de silex sont encore en activité vers – 2200 à – 2000 avant notre ère, en Pologne et en Angleterre. Le remplacement du silex par le métal se fera progressivement et l’outillage en silex continuera à être utilisé durant la première partie de l’Age du Bronze.
Les terrains Turoniens comme celui où se trouve la cavité sont riches en blocs de silex.
Les bancs de silex sont extraits par le creusement de courtes galeries de 2 à 5 mètres de long partant du puits d’accès.
Si cette hypothèse est la bonne on doit trouver à proximité des éclats et des rognons de silex.
Ceci est assez difficile car la végétation est dense et le sol dans la forêt est recouvert d’un épais humus.
Cependant, sur le chemin passant au-dessus de la cavité à une quarantaine de mètre, on trouve de nombreux blocs et éclats de silex noir ou gris.
4° hypothèse : C’est une mine d’extraction de silex pour la fabrication des pierres à fusil.
La taille du silex est effectuée comme pour les pierres percutées du néolithique, par des outils à percussion styles masses ou marteaux l’homme a réinventé la percussion, vers la fin du XVI° siècle comme dans la préhistoire.
Figure 166-11. Tailleur de pierres à fusils.
Figure 166-12. Pierres à fusils trouvées sur la commune. Photo de l’auteur
Figure 166-13. Exemple: platine à silex du fusil mle 1777 an IX de la révolution.
Ceci peut être aussi une hypothèse, bien que ce soient les silex blonds qui étaient préférés pour cette utilisation, et quoique ceux trouvés sur la commune sont gris.
Le seul bémol concernant cette hypothèse est que, depuis que les terres sont cultivées il est facile de trouver au sol du silex à tailler sans être obligé de creuser une cavité de plus de 150m3 !
Mais ce sont des hypothèses et comme toutes hypothèses elles doivent être démontrées.
Il ne reste qu’une chose à faire : descendre dans le trou. Si j’avais quelques ans de moins ce serait fait il y a longtemps. J’attends des volontaires …
V.XV – LES CONSTRUCTIONS.
Les constructions anciennes ou très anciennes qui sont encore debout aujourd’hui sont rares. De l’époque romaine, seules subsistent les constructions qui ont été réalisées en pierre de taille assemblées à sec ou avec un mortier de chaux ou de terre. C’est le cas des grands monuments que nous connaissons tels que le pont du Gard, les arènes de Nîmes et d’Arles ou encore le théâtre d’Orange.
Quant aux maisons d’habitations depuis l’époque gallo-romaine, elles étaient construites suivant quatre techniques fondamentales qui mettaient en œuvre de la terre. Ce sont le torchis, la brique de terre crue ou adobe et le pisé, auxquelles il convient d’ajouter le pan de bois ou architecture à colombages qui associe le bois et la terre et enfin la pierre brute ou taillée assemblée sèche ou au mortier de chaux. Parallèlement à ces emplois architecturaux, la terre pouvait également participer à la construction sous la forme de liant dans des murs en pierre ou en brique, d’enduit de parois sur toutes sortes de supports, ou bien encore de toit de torchis, de plafond, de sol et de divers aménagements intérieurs.
Le torchis.
Technologiquement, le torchis se définit ainsi : sur une armature de branchages, de roseaux, de lattes, etc., entrecroisés et soutenus par des pièces de bois plus solides, on applique en couche généralement épaisse, et en le faisant pénétrer dans les interstices du clayonnage, un mélange de terre et de végétaux, contenant parfois du sable ou des graviers, à l’état semi-liquide. Eminemment périssable du fait de son infrastructure végétale, le torchis ancien a peu de chances d’être retrouvé en place.
La brique en terre crue ou adobe.
Elle reflète un mode de construction avancé, au même titre que la pierre, puisque l’emploi régulier de ces matériaux aurait été introduit sur le littoral méditerranéen de la Gaule par les Grecs au VI° siècle avant JC. La brique se distingue fondamentalement du torchis et du pisé en ce sens que c’est un matériau de série dont la mise en œuvre exige la préparation en grandes quantités et à l’avance car, aux dires de Vitruve (célèbre architecte romain qui vécut au Ier siècle av. J.-C.), deux années de séchage sont nécessaires ! Les briques sont habituellement obtenues en pressant dans des moules un mélange de terre et de végétaux, mais certaines paraissent dépourvues de paille et d’autres renferment parfois des graviers.
Il y a de très beaux vestiges de ces constructions dans certains quartiers de Nîmes. Ces vestiges ont été mieux conservés dans les soubassements des habitations des villes que dans les constructions isolées des campagnes, plus exposé aux intempéries, aux guerres et aux pillages.
Le Pisé
Ce terme d’origine lyonnaise désigne une maçonnerie de terre crue tassée dans un coffrage de bois (banche) de la largeur du mur que l’on désire obtenir. Le matériau idéal contient environ une moitié de sable (et de gravier, de 0 à 15 %) et une moitié de limon et d’argile, et exclut tous les végétaux, susceptibles de pourrir. Comme pour le torchis, les constructions de ce type ne peuvent guère se conserver longtemps.
Le pan de bois ou construction à colombage
L’architecture à pan de bois, courante au Moyen Age, est de nos jours encore largement répandue dans les provinces françaises, mais son importance à l’époque gallo-romaine est certainement plus méconnue.
On entend par « pan de bois » un assemblage de pièces horizontales, verticales et parfois obliques, formant l’ossature d’un mur dont les vides sont ensuite remplis par des briques, cuites ou crues, du torchis, etc. La plupart du temps ces murs sont, comme les murs d’adobe et de torchis, isolés de l’humidité des sols par un soubassement maçonné qui peut monter jusqu’à un étage.
La tuile romaine
Nous avons parlé au chapitre III des tuiles romaines « tegulae et imbrice » leur mode de fabrication se faisait de la façon suivante, voici un moule à tegula (tuile plate) et un moule à imbrex, (tuile canal).
On « graisse » le moule avec du sable mouillé, pour éviter que la tuile n’adhère au moule et au socle. Le moule à tegula est rempli de terre glaise et on retire par raclement la terre en excès.
Figures 167. Photos Fabrice Charlier la tuilerie gallo-romaine de Moissey
Ci-après, on démoule la tegula avec soin
Ci-dessous on prépare l’imbrex (tuile canal)
On remplit un moule en bois qui est le strict développement de l’imbrex et on dépose la plaque obtenue sur la forme à imbrex, pour lui donner la courbure.
Figures 168. Photos Fabrice Charlier la tuilerie gallo-romaine de Moissey
Les deux pièces sont prêtes à sécher puis à cuire. Ci-dessous tegula imbrex datant de l’époque romaine.
Figures 169. Photo de l’auteur
V.XVI – LITIGES ET CONFLITS DE LA VIE QUOTIDIENNE.
Conflit avec le seigneur St André d’Olérargues
J’ai évoqué au Chapitre IV et au sujet du XVIII° siècle les litiges entre les habitants et le seigneur du lieu. Il me faut préciser ici que le dit seigneur n’habitait pas le château. Cette bâtisse était occupée par un ou des employés ou un régisseur qui s’occupait de l’exploitation et de la rentabilité de la propriété. On trouve dans les archives pour désigner cette personne les termes de « rentier » (celui qui assure la rentabilité) ou tout simplement « domestique ». Cet employé était tenu aussi d’entretenir et de tenir prêt le logement du seigneur qui pouvait venir y loger quand bon lui semblait, lors d’un déplacement ou pour une partie de chasse ou encore quand il venait toucher la sencive due par les habitants cultivant ou utilisant les terres de la seigneurie.
Les litiges contre le seigneur ont de tous temps existé mais pendant des siècles les habitants n’ont eu comme solution que se taire, courber l’échine et subir.
Au fil des siècles, notamment à partir du XVII° et surtout au XVIII° siècle, de plus en plus de villageois commencent à savoir lire, même s’il y a encore une majorité d’illettrés.
Au XVIII° siècle la révolution est sous-jacente.
Les villageois représentés par leurs consuls contestent l’autorité des nantis. Ils interprètent à leur avantage les écrits anciens, ils font des procès car ils sont sûrs de gagner, mais tout n’est pas si simple…
C’est contre Messire Vivet de Servezan que les habitants se révoltèrent par voie juridique. C’est une longue saga qui dura de 1737 jusqu’à 1816, elle sera entretenue par les différents propriétaires qui se sont succédé jusqu’à la perte de la nobilité du fief et la vente ou appropriation par morceaux du bien initial. Rien que dans les archives paroissiales il y plus de 250 pages d’actes, suppliques, inventaires, plaidoyers sur le sujet !
Le tout n’a rien à envier aux « Plaideurs » de Pierre Corneille ! Pour qui est patient, c’est à lire. Je renvoie aussi à la monographie du chanoine Roman qui retranscrit l’ensemble des textes qui ne sont pas dans les archives locales.
C’est en 1737 que Louis André de Vivet de Servezan prend possession de la terre de St André d’Olérargues par rachat à Paul de Reynaud. Il n’y a aucun document relatif à la gestion de ce seigneur dans les archives locales, nous dit le chanoine Roman. Le 12 mai 1758 un procès-verbal est dressé parMonsieur de Montolivet Commissaire nommé par arrêt de la Cour des Aides et Finances de Montpellier.
Il nous révèle que Messire Vivet de Servezan eut à subir une enquête réclamée par la communauté de St André d’Olérargues qui prétendait lui contester la nobilité foncière de la seigneurie. Elle remettait en cause sa probité et son honnêteté vis-à-vis de ses biens situés sur le territoire de la commune en regard du compoix fait en l’année 1633. On suppose alors, qu’il aurait été falsifié par le Seigneur et son rentier Jean Roman.
Le dit Jean Roman grâce à la pression du Seigneur sur les habitants est resté premier ou deuxième consul pendant plus de quinze ans.
Les consuls étaient élus par le suffrage de tous les habitants. Seuls les chefs de famille et les chefs des métiers, étaient électeurs, les femmes y compris lorsqu’elles étaient veuves ou marchandes publiques en leur nom propre. La durée du mandat des consuls était généralement d’un an.
Jean Roman s’était approprié le compoix pour le compte de Vivet de Servezan en 1743 et ne voulait pas le rendre. Ce cadastre ancien était le document qui permettait de définir quels étaient les biens nobles donc exempts d’impôt et quels étaient les biens roturiers soumis à la taille. En 1758 Jean André, premier consul fait faire par l’avocat Maitre Moureau une supplique à la Cour des Aides et Finances de Montpellier pour obliger Messire de Vivet de Servezan à rendre le compoix.
Ci-après la première page de cette supplique il est écrit :
« A Nos seigneurs des Comptes Aydes et Finances.
Supplie humblement Jean André premier consul de St André d’olleyrargues dit avouer qu’en l’année1743 il eut la facilité de prêter à André de Vivet de Servezan seigneur du dit lieu de St André d’olleyrargues le compoix moderne de la dite communauté en ayant besoin pour quelques éclaircissement. Mais n’ayant pas moyen de le luy faire rendre le suppliant lui fit un acte le 24 aout 1744 pour le sommer de rendre le dit compoix, ne daignant satisfaire au dit acte le suppliant se pourvoit en la cour et obtint une ordonnance le 17 aout 1748 portant la remise du compoix ; le suppliant fit signifier la dite requête audit de Servezan. Il répondit que ledit compoix était entre les mains de Jean Roman 2eme consul qui est son domestique résidant dans son château (…) »
Il s’était passé cinq ans depuis le jour du prêt.
Figure 170. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Ce n’est qu’en 1758 qu’il sera rendu !
Le compoix était donc resté aux mains de Vivet de Servezan de 1743 à 1758, soit quinze ans !
Il s’en suit une requête auprès du Juge Royal de la Ville de Bagnols qui autorise le contrôle et la mise à jour du compoix par des experts mandatés par lui.
Les 26-27-28 Juin 1758 un examen minutieux et très mouvementé dans les séances publiques est fait du compoix et un rapport de 60 pages en est établi.
Il commence ainsi :
« L’an mil sept cent cinquante-huit et le mardy vingt eme jour du mois de Juin par devant nous François de Catvet Mourgier Seigneur de Montolivet Commandeur du Roy et sou viguier en la ville et viguerie royale de Villeneuve les Avignon dans notre hôtel au dit Villeneuve heure de sept après midy, suivant sous nous Antoine Joseph Maluit sousfenuier de notre greffe auquel avons fait prêter le serment en tel cas requis la main mise sur les évangiles.
Est comparu Sieur Michel Soulier premier consul du lieu de St André Doleyrargues faisant pour et au nom de la communauté avait en la souveraine cour des Compte Aydes et Finances de Montpellier contre le Sieur de Vivet de Servezan Seigneur du dit lieu, et Jean Roman il a été rendu arrêt le Douzième May dernier portant que les dits Sieur de Servezan et Roman en exécution de son ordonnance du dix-septième aout mil sept cent quarante-huit remettront le compoix, et adition dont s’agit entre les mains du greffier de la dite communauté pour être ensuite remis dans un coffre fermant à deux clés dont l’une restera au pouvoir du premier consul et l’autre en celle du dit greffier (…)
Voir ci-après le fac-similé de la première page.
Figure 171. Page d’introduction du rapport de vérification du compoix. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Et c’est ainsi que le fameux compoix est revenu aux mains de la communauté qui va en faire faire la vérification et la mise à jour éventuelle.
Cet examen est public, avec des discussions passionnées et contradictoires en la présence du greffier consulaire Maitre Dézier représentant de la communauté et du notaire et avocat représentant et défendant de Vivet de Servezan, maitre Chambon. Le Compoix est examiné folio par folio, ligne par ligne et mot à mot. Il faut dire qu’il comprend en plus des plans, les descriptions des parcelles et les allivrements cadastraux. C’est à dire le revenu net et imposable assigné par le cadastre aux propriétés foncières.
Je reproduis et réécris une page de ce rapport pour l’exemple c’est la quinzième page.
Figure 172. Page 15 du rapport de vérification du compoix. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Retranscription de la page 15 ci-dessus:
« (…) du dit folio verso le mot a été effacé et on a mis pardessus le mot cinq ce qui a prouvé le changement des chiffres de l’allivrement, plus avons trouvé qu’au folio cinquième on a effacé au chiffre de l’allivrement huit deniers qu’il y avait en les réduisant à quatre, et que le tout parait être ancien suivant les maitres Chambon et Dézier nous l’on fait observer, et attendu l’heure tourne celle de cinq étant passée, et que dans le dit lieu de St André nous n’avons pu trouver aucun lit pour coucher, ni même de quoy y souper nous avons renvoyé la continuation de notre présent procès-verbal à Demain heure de huit au matin en ladite ville de Bagnol, et dans le logis du Sieur Mouveirol ou pend pour enseigne Le Cheval Blanc et ce par le consentement de toute les parties auxquelles nous enjoignons de s’y trouver lesquelles ont promis de faire sans autres formation faute de quoy elles consentent qu’il y soit procédé en leur absence, Le compoix dans lequel y acté mis ladite adition ayant été par nous ficelé en croix, et sur le nœud de la dite ficelle avons aposé une bande de papier par nous paraphée avec toute les parties et cachetée sur les deux extrémités d’ycelle en cire rouge au sceau de nos armes lequel compoix a été remis à notre greffier au consentement des parties.(…) »
Comme je l’ai dit il y a ainsi soixante pages de la même veine. Cette vérification va donc se poursuivre au cabaret à l’enseigne du Cheval Blanc à Bagnols, l’atmosphère n’y sera pas toujours sereine … !
« Au cabaret du Sieur Mouveirol à l’enseigne du Cheval Blanc est comparu le Sieur maitre Cabrol faisant pour la communauté assisté du Sieur Soulier Consul qui nous a dit que sur les réquisitions cy-devant faites tant par luy que par ledit Sieur Soulier pendant les jours de la procédure, le Sieur de Vivet de Servezan Seigneur de St André n’a cessé de le menacer, qu’il lui a même dit qu’il le luy payerait, et que Maitre Chambon notaire et juge dudit Seigneur, et qui a fait les réquisitions a toujours parlé au dit Soulier d’une manière méprisante, le traitant de drôle, et luy ayant même imposé le silence, que ledit Maitre Chambon l’a encore accusé dans ses comparants d’avoir commis le crime de félonie envers son Seigneur et que tant ledit Seigneur que ledit Maitre Chambon n’ont cessé de lui dire qu’il s’en repentirait, qu’on le ruinerait, qu’on l’écraserait, et qu’on le mettrait à l’hôpital, que ledit Soulier ne comprend point dans quelle visée ces grand mots ont été dits sinon qu’on a voulu l’alarmer et l’obliger de se retirer puisque ledit Soulier n’a jamais eu garde de manquer en aucune manière audit Seigneur de Servezan. Son Seigneur qu’il a toujours respecté et respectera toujours. Mais qu’il n’a eu d’autres motifs que ceux de faire le devoir de sa charge de consul, et de soutenir les intérêts de la communauté que les long comparants et les longs imidants qu’a fait et formé ledit Maitre Chambon toujours assisté dudit Sieur de Servezan qui n’ont servi qu’à allonger la procédure ont obligé ledit Soulier qui avait envie de l’abréger et d’assurer les frais qui doivent être néanmoins supportés par ledit Sieur de Servezan et Jean Roman son rentier ainsy qu’il résulte de l’arrêt saisir recours au comparant pour l’aider de ses conseils, et répondre aux comparant dudit Maitre Chambon comme ne le sentant point en état de le faire par lui-même, et qu’il a été encore obligé de faire venir ledit Sieur Dézier greffier de la communauté pour être présent pendant les jours de la procédure, et qu’il faudra payer l’un et l’autre, qu’il n’accuse personne nommément d’avoir enlevé les feuillets ni d’avoir écrit les interlignes, et fait les rayures biffures et altérations du compoix, mais qu’il se réserve pour, et au nom de la communauté de prendre les voyes de droit contre ceux qui pourront en être coupables ; que ledit Soulier Consul soutient tant seulement qu’il est notoire dans la communauté de St André que les biens que possédaient les anciens prieurs étaient Compoisiés et renfermés dans les premiers feuillets qu’on trouve manquer audit Compoix sont jouis par ledit Sieur de Servezan, que lesdits feuillets étaient suffisants pour soutenir tous les états des biens que possède ledit Seigneur, qu’il a été dit audit Soulier dans la maison du Sieur Mézier du Mas de Cellier paroisse sud de St André, et par la famille que le Sieur Mezier père, qui lit, mort depuis peu âgé d’environ quatre-vingt-dix ans avait dit souvent que le Seigneur dudit St André n’avait point de biens nobles et qu’il dépendait de la communauté de les mettre à la taille et que c’est de là que la communauté a inféré que ledit Seigneur de St André, ou ledit Roman son rentier détenaient le compoix pour qu’on ne puisse pas prendre les éclaircissements convenables requérant de lui donner acte de tout ce refus et notamment que le premier feuillet qu’on trouve manquer audit compoix contenait en tout ou en partie les biens que possède maintenant le dit Seigneur de St André sans en payer la taille (…) »
On constate à la lecture de ce rapport que le Seigneur de Vivet de Servezan n’est pas net dans ses agissements et que la communauté n’a pas non plus de preuve irréfutable contre lui.
Ce litige durera jusqu’en Juillet 1772. Messire de Vivet de Servezan est alors décédé et c’est sa veuve Elisabeth de Laurens qui lui succède conjointement avec son gendre Messire Gabriel de Brueys, Baron d’Aigalliers et qui continuent les procès. En 1751 naquit son fils François qu’il fit émanciper en 1770 et qui devient Baron de St André.
Il y avait en cours une foule de procès :
-
- – A la cour des comptes Aydes et Finance de Montpellier pour prouver la roture des biens du Seigneur.
-
- – Au tribunal de Nimes pour la justification de propriété des biens du Seigneur, la directe universelle et la cassation des reconnaissances générales de 1608, 1644 et 1680.
-
- – A la maitrise sur la portion du prix des coupes de bois revenant au Seigneur.
-
- – Au tribunal sur la directe du territoire de Berben.
-
- – Au parlement sur la cassation de certaines délibérations.
Tous ces procès ont été terminés par une transaction du 4 Juillet 1772 entre François de Brueys et la communauté d’après l’avis de trois arbitres Maitres Baragnon, Blanchard, Goirand avocats et juges mages d’Uzès et l’autorisation de Monsieur l’Intendant de la province.
Le 8 mai 1772 un conseil communal renforcé de tous les chefs de famille est convoqué, il y a :
Messieurs Soulier et Joseph Prade Consuls, Etienne Frac, Simon Puget, Pierre Lauron, Joseph Prade fils de Louis, Pierre Barnouin, Etienne Mathon, Laurent Beylesse, Joseph André, André Teissier, Pierre Teissier, Noë Dardillon, Baptiste Fontanille, André Prade, Jean Lauron, Pierre Sauze, Etienne Coste, Simon Soulier fils d’autre, Jean Mégier, Pierre Lauron, Michel Soulier du Mas, Jean André, Jean Etienne de Christol, François Sauze, Pierre Labeille, Jacques André, Jean Vignal du Mas, Louis Bégon, Gabriel Charavel, Antoine Teissier père, Guillaume Prade, Antoine Mazan neveu, Antoine Mazan oncle, Paul Jouvenel, Antoine André, Joseph Ponsonnet, Jean Fabrègue, François Carretier, André George, André Tressol, faisant la plus grande et principale partie des habitants taillables de St André.
Ce qui représente une quarantaine de familles. A l’issue de ce conseil après avoir pris une parfaite et entière connaissance du projet de transaction l’assemblée a unanimement délibéré qu’il était de l’intérêt de la communauté d’accepter le compromis avec le Seigneur. L’accord est signé le 4 Juillet.
Que prévoit cette transaction en résumé ?
En premier lieu, la communauté renonce à tous les procès en cours contre le Seigneur du lieu.En second lieu
- , les biens fond possédés par le Seigneur dans le taillable de St André sont déclarés roturiers et contribueront donc aux impositions.
En troisième lieu
- , le Seigneur payera au Collecteur des impôts de l’année 1773 la somme de 800 livres à la décharge de la communauté qui en sera d’autant moins imposée. Moyennant cette somme il sera libéré de tous les arriérés.
En quatrième lieu
- , la communauté est maintenue en la propriété des bois, pattus, terre vaines et vagues, garrigues et vacans dans toute l’étendue du territoire.
En cinquième lieu
- , les bois du territoire seront mis en coupe réglée et vendus par la communauté avec la permission du Seigneur, le quart du prix de vente sera versé au Seigneur. Bien entendu le Seigneur et les habitants pourront prendre du bois en conformité des règlements pour leurs fours, chauffage, outils, réparation de leurs maisons sans pouvoir en transporter hors de la juridiction.
En Sixième lieu
- , la communauté renonce à réclamer au Seigneur ce qu’il a pu recevoir au-delà du quart du prix des ventes passée.
En septième lieu
- , si les herbages ou la glandée dans les bois, pattus, terre vaines et vagues, garrigues et vacans dans toute l’étendue du territoire viennent à être vendus, il faudra la permission du Seigneur et le quart de la vente lui reviendra.
En huitième lieu
- , les particuliers qui voudront défricher ne pourront le faire qu’en vertu d’une délibération de la communauté communiquée au Seigneur qui aura la préférence de le faire pour lui-même.
En neuvième lieu
- , il sera permis au Seigneur et aux habitants de faire des fours à chaux pour leur propre usage.
En dixième lieu
- , la communauté reconnait et déclare tenir du Seigneur bois, pattus, terre vaines et vagues, garrigues et vacans dans toute l’étendue du territoire. Chaque habitant est tenu de reconnaitre au Seigneur le droit de lods et le cens à raison du quart pour tous bâtiments construits et à construire. A savoir pour tous les bâtiments quelle que soit leur utilisation, sont soumis à la censive d’une bonne poule et pour les autres biens fond d’un boisseau de seigle marchande mesure de Bagnols pour chaque salmée (environ 64 ares) de terre. Les censives sont payables et portable au château de St André annuellement à la fête de St Michel Archange.
En onzième lieu
- , le seigneur réduit et abandonne toutes les anciennes censives et redevances en argent, grain, part de fruit et autre qui pourraient lui être dus par la communauté ou les particuliers.
En douzième lieu
- , les particuliers qui ont des maisons ou des biens fond dans le territoire de Berben ne seront tenus de faire aucune reconnaissance, ni de payer aucun lods et censives au Seigneur.
En treizième lieu
- , le Seigneur libère tous les Emphytéotes (possesseurs de bail de très longue durée) de tous les arriérés de censives et autres droits seigneuriaux. Dus jusqu’à la St Michel dernière.
En quatorzième lieu
- , la communauté sera tenue de se conformer aux arrêts et règlements pour la forme de ses délibérations.
En quinzième lieu
- , toutes les clauses de la présente transaction doivent être considérées comme unes et indissociables.
Tout semblait donc aller pour le mieux, quoique …
Messire François de Brueys sentant peut-être l’instabilité du climat politique de ces années prérévolutionnaires, vend la terre et la seigneurie à Messire de Bruneau Charles Prudent (pas assez à mon avis) d’Ornac Baron de Verfeuil.
Et on recommence …
Les habitants de ST André d’Olérargues ont eu en 1790 ou 1791 la permission de Monsieur l’Intendant de plaider pour faire casser la transaction passée en 1772 qu’ils jugeaient être à leur désavantage!
Les Olérargais mettent la pression et le Baron de Verfeuil eut à subir dans son château l’invasion d’une bande de gens armés de St André d’Olérargues qui, sous la conduite du premier consul, vinrent manifester contre leur nouveau Seigneur d’une manière plus qu’inconvenante, dit le chanoine Roman.
Le Baron de Verfeuil fait durer la procédure, citant des témoins de l’invasion de son château, qui affirment avoir vu le maire et trois officiers municipaux de St André d’Olérargues feuilleter tous les titre dudit Baron et qu’ils ont été maître d’en soustraire quelques-uns.
En 1803 le Baron de Verfeuil meurt. Sa veuve reprend la procédure, écrit plusieurs fois à Monsieur le préfet du Gard à Nîmes. Elle n’obtiendra aucune réponse.
En ces temps troublés les Préfets ont autres choses à faire que de défendre les privilèges de la noblesse. Lasse, elle vend ses terres et châteaux de St André d’Olérargues en bien roturiers et en diverses ventes partielles.
Et ainsi en 1816 la seigneurie de St André d’Olérargues n’existe plus en tant que telle.
Litige entre villageois
Nous avons vu que Michel Soulier s’était battu pour récupérer le compoix et défendre les intérêts de la communauté pendant le contrôle de celui-ci. Nous avons vu aussi les menaces proférées par Vivet de Servezan qui promettait de le lui faire payer ! Qu’en est-il advenu ?
On trouve dans les archives un document tronqué, il manque les deux première pages et une ou plusieurs à la fin. Il nous en reste quatre. Cela ressemble à une requête auprès de la cour des Comptes, Aydes et Finances de Montpellier contre Michel Soulier à qui l’on reproche le zèle qu’il mit à défendre la communauté et son enrichissement personnel.
Cette requête semble bien émaner directement ou indirectement du Seigneur. Je transcris :
« (…) et le Sieur Soulier qui en était alors consul avait capté la confiance des habitants au point qu’il se fit députer dans tous et il ne manquait pas utiles ou non de faire des voyages très fréquents et des long séjours auprès des tribunaux devant lesquels les procès étaient pendant, et à l’adresse de se faire ainsi un patrimoine des revenues communaux, il joignait celle de forcer les malheureux habitants à se saigner pour fournir aux dépenses inutiles qu’il savait faire à la communauté et desquelles il profitait seul. C’est de cette manière que s’est formé l’état exorbitant des fournitures prétendues faites par le Sieur Soulier mais dont la plus grande partie n’est pas prouvée tandis que l’autre se trouve surpayée ou en déduction des cas qui ne sont pas justifiés ou qui doivent rester sur le compte de la communauté comme ayant été payés de ses propres deniers. Elle s’est prouvée sur un bien grand nombre de cas (…)
Figure 173. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Il est accusé dans le même document d’avoir profité personnellement des emprunts contractés par la commune auprès d’André Frac de la Roque.
La vengeance de Vivet de Servezan s’était donc abattue sur le pauvre Soulier. N’oublions pas qu’il a été accusé par de Vivet de Servezan de « félonie » c’est-à-dire qu’il aurait offensé son Seigneur dans son honneur et dans sa personne et à ce titre si cela était prouvé il pouvait perdre la maison et les terres qu’il exploitait en tant qu’emphytéote. Le Seigneur était en droit de récupérer ses biens et mettre à la rue Soulier avec femme et enfants.
Un autre petit document trouvé dans les archives, je le cite juste pour la curiosité. C’est une reconnaissance de dette de Michel Soulier à Jean André. Sans doute pour faire face aux frais des procès puisqu’il le fait en tant que consul et suivant l’ordonnance de Monseigneur l’Intendant. Ceci prouve aussi que Jean André avait les moyens … On remarquera aussi que Soulier est écrit par lui avec deux L alors qu’il n’y en a qu’un dans les documents précédents.
« Je soussigné Consul de la comté de St andré Dollayrargues Déclare avoir reçu de Jean André du mas du cellier la somme de seize louis quil ma remisse en conséquence de l’ord ce de monseigneur L’intandan du 23 e 9 bre 1766 et de la délibération de la comté du 9 e X bre 1771 pour luy etre remboursé l’inthéret suivant ladite ord ce fait le 19 e X bre 1771 Soullier Consul »
Figure 174. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Autre litige entre villageois
Comme nous venons de la voir précédemment, pour faire face aux frais des nombreux procès et en vertu d’une ordonnance du 23 novembre 1766 de Monseigneur l’Intendant, les habitants les plus aisés étaient tenus d’avancer le montant de ces frais. Ils étaient remboursés plus tard moyennant intérêts si tout allait bien, si les consuls n’avaient pas changé, s’ils étaient honnêtes et de bonne foi et si le créancier avait l’autorité suffisante pour exiger son dû. Ce qui fait beaucoup de conditions … !
C’est ainsi que 15 décembre 1765 Gabriel Charavel est contraint d’avancer la somme de vingt-quatre livres pour des frais de justice concernant la communauté et c’est seulement le 9 décembre 1787 au cours d’une délibération du conseil de communauté qu’il a été :
« (…) délibéré et consenti à la vérification des sommes qui sont dues au Sieur Gabriel Charavel (…) »
Figure 175. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Un an après rien n’a bougé et Gabriel Charavel saisi la justice et transmet une supplique à Monseigneur de Ballainvilliers Intendant de la province de Languedoc.
Figure 176. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Comme il le précise les Consuls et administrateur de la communauté ont laissé sa vérification en souffrance tandis
« qu’ils ont mis toute l’ardeur possible pour faire vérifier et imposer les frais qu’ils avaient eux-mêmes exposés (…) »
Mais Gabriel Charavel décède et son fils reprend la lutte, à son tour il refait une supplique à Monseigneur de Ballainvilliers Intendant de la province de Languedoc.
Figure 177. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Figure 178. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
On constate ici que la solidarité et l’entente entre les membres de la communauté était loin d’être exemplaire, jalousie et rivalité étaient de mise. On se rend compte qu’il était facile pour le Seigneur du lieu d’opposer les uns aux autres. Je retranscris une partie des paragraphes ci-dessus qui sont très imagés.
« Au lieu par ce consul de remplir ses engagement il s’est opiniâtré depuis à faire soutenir par la communauté, divers procès qu’elle a toujours perdus et s’est occupé ensuite à faire vérifier et imposer les sommes qu’il a voulu, en faveur de ceux qu’il lui a plu de favoriser et a toujours laissé à l’écard le supliant.
A ces causes il vous plaira Monseigneur à condamner personnellement le dit Pierre Lauron consul en 1787 et qui s’est encore fait élire en 1789 au mépris des règlements et en apellant au conseil des individus qui ne sont point conseillers politiques (…)
Malheureusement, par manque de documents, l’histoire ne dit pas s’il a été remboursé, il y plus de trente pages de procédure sur le sujet dans les archives. Ce que l’on peut dire c’est qu’en 1792 le litige durait toujours. L’argent avait été prêté 27 ans plutôt !
V.XVII – AUTRE CURIOSITE DOCUMENTAIRE DU VILLAGE.
J’ai écrit au paragraphe XII du présent chapitre, qui concernait LES ACTES ECRITS DE LA VIE QUOTIDIENNE, que le Prieur Camerle avait tenu sa charge jusqu’en 1698. L’année suivante alors qu’il était cloué au lit par la maladie, il dicte son testament. Il y a cinq pages, je vais en faire la transcription page après page en sautant les mots que je n’aurai pas réussi à relire et en reproduisant l’orthographe à peu près tel qu’elle est dans le texte.
Figure 179. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
Testament
L’an mil six Cent nonante neuf et le deuxième jour du mois de juillet après Midy du Règne du très Chrétien prince Louis par la grace de dieu Roy de France et de Navarre par devant moy notaire Royal (…) en la présence des témoins nommés, a été en personne messire Dominique Carmerle prêtre et prieur du lieu de St andré Dolleyrargues, Lequel gissant dans son lit atteint de maladie corporelle. Considérant savoir rien de plus certain que la mort, et chose de plus incertaine que l’heure d’ycelle désirant auparavant que cela arrive de disposer des biens qui a plu à ce grand Dieu de luy donner. L’invoquant à son âge de le (…) et le prie que, quand son âme se séparera de son corps Il la ramène dans son paradis, élisant sépulture dans le presbitaire de l’église parroissialle de St andré tombeau de ses prédécésseurs et ses honneurs funèbres être fait à la discrétion de son héritier, il a donné et légué, donne et lègue à la vénérable Confrérie du très St Sacrement de l’autel érigé dans la dite Eglise la somme de Cinquante Louis qui sera destinée pour achepter une croix voulant que ladite somme soit destinée à ce seul uzage, Item le dit testament a donné et légué pareille somme de Cinquante Louis pour être employé à faire des réparations à ladite Eglize. Item ledit testament a donné et légué Donne aux vrayment pauvres dudit St andré quatre saumées de blé (soit 566 kg) tous égal distribuables en pain cuit à la porte de sa maison savoir la moitié le jour de sa naissance et l’autre moitié le jour de l’an d’après son décès. Item a donné et légué aux pauvres de la paroisse dudit St andré et non d’ailleurs deux pieces de cadis (tissu de laine étroit et léger) de maison que ledit testateur a dans sa maison tirant environ trente canes (environ 60 m) lesquelles seront destinées pour habiller les pauvres et que ledit Pierre Delaine dudit lieu jugera à propos qui …/…
Figure 180. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
…/… seront tenus d’assister à l’enterrement dudit testateur et de le conduire à la sépulture et aussi de prier dieu pour le salut de son âme, encore ledit Sieur prieur testateur a donné et légué auxdits pauvres dudit lieu de la parroisse la somme de cinq cent livres laquelle somme de cinq cent livre sera prise sur les (biens) actifs qu’il a dans la dite parroisse et en cas lesdits (biens) ne surviendraient pas à payer la somme de cinq cent livre il nous ordonne que ce qui manquera soit pris sur le total de ses autres biens (…) legal. Il prie les pauvre de la dites paroisse de se voulloir contenter et veut qu’autre chose ils ne puissent rien plus prétendre. Item. Ledit testateur a donné et légué donne le lègue au couvent des révérents père (…) de la ville de Bagnols la somme de trente six livres en reconnaissance du service qu’ils ont fait ou fait voir a sa parroisse pendant sa maladie. Item Il a donné et légué au révérent père Cordelliers de la ville de Bagnols trois Eyminés de blé et tozelle (60 kg de froment) aussy en reconnaissance du service qu’ils ont fait à la parroisse et les prie les uns et les autres de voulloir dire des messes pour le salut de son âme payable en deux legat par son héritier s’il est nommé incontinent après son décès. Item le testateur a donné légué donne et lègue a Catherine Courte femme de Pierre Lagrollière habitante de la ville d’Uzèes la somme de quinze livres et moyennant lequel legat elle ne pourra demander à son héritier le service qu’elle a fait à sa maladie le susdit légat par son héritier incontinent après son décès, Encor il donne le lègue à Gabrielle de Laville veuve de Jacques Flandrin habitante dudit St André la somme de dix sept livres laquelle somme de dix sept livres elle se retiendra sur plus grande qu’elle (…)
Figure 181. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
…/… doit au Sieur prieur testateur. Item Il donne et lègue à Jacques Reboul fils de Claude de Verfeuil qui est à son service la somme de douze livres qui sera destinée pour lui apprendre un métier et moyenant lequel lègat ledit Jacques Reboul ne pourra rien demander à son héritière du temps qu’il reste à son service, payable ledit lègat par sa dite héritière sus nommée. Item ledit testateur a donné et légué donne et lègue à Antoine Coste fils de Guilhaume la somme de Quatorze livres laquelle somme ledit Coste la prendra sur les sommes que Guilhaume Coste son père lui doit lequel lègat se prendra sur celuy des cinq cent livres. Item il a donné et légué à Louis Lauron fils dudit Etienne Quinze livre qu’il prendra sur ce que son père luy doit et aussy les dits quinze livres fairont diminution sur le lègat de cinq cent livres. Item ledit testateur a donné et légué donne le lègue à Sieur Jacques Magnon Bourgeois du lieu de Banon en Provence la somme de trois cent livres à luy payables l’an d’après son décès. Encore Il a donné et légué donne et lègue a Sieur Louis Magnan fils de Jacques Magnan pareille somme de trois cent livres laquelle somme sera destinée pour les études dudit Magnan pour son séminaire (…) Item ledit testateur a donné et légué donne et lègue à Blaise Camerle fils de feu Alexandre habitant dudit lieu de Banon son berceau la somme de trois mille livres laquelle somme de trois mille livres sera payable savoir mille livres qui sont données audit Sieur prises sur l’héritier de feu Jacques Camerle père dudit testateur pour ses droits de légitime paternel et maternel, Mille livres à laquelle se peut porter l’héritage de feu Sieur Pierre Camerle frère du dit testateur et duquel il est héritier et les autres mille livres pour semblable somme que ledit Sieur prieur …/…
Figure 182. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
…/… paye à la décharge dudit Blaise Camerle à Sieur Laurens Carrettier habitant du lieu de St Victor de la Coste mary et maitre des biens dotaux de Dame Anne Camerle et ycelle fille dudit feu Sieur Alexandre Camerle pour ses droits de légitime paternel et maternel, aux droits de laquelle ledit Sieur prieur se trouve subrogé par le contrat de leur mariage et avec lequel légat le testateur veut que son dit neveu se contente et qu’autre chose il ne puisse prétendre sur le restant de ses biens, même ledit Sieur testateur n’entend point préjudicier à son héritière sus nommée la moitié de la récolte qui luy appartient audit héritage ni non plus à la somme de trois cent livres qui lui est dû tant par le dit Blaise Camerle que le dit Jacques Magnan et autres sommes qui peuvent lui être dues fait par eux ou d’autres particuliers.
Item Ledit Sieur testateur a donné et légué à Marie Magnan fille d’Esprit Magnan dudit lieu de Banon la somme de cinquante livre, payable ladite somme de cinquante livre une année après son décés, Et finalement yceluy testateur a donné et lègue donne et lègue à tous autres ses parans ou prétendant droit sur ses biens Cinq sol payable le jour de l’an de son décès et veut que autre chose ils ne puissent prétendre et parce que l’institution desdits héritiers ou héritière est le chef et fondement ouïr chaqu’un de nier le valable testament a cette cause Ledit Sieur Camerle testateur de tout le restant de ses autres biens, noms, droit, raison tractions meubles immeubles de présent ou pour l’avenir à fait instituer et de sa propre bouche nommé son héritière Universelle et générale ladite demoiselle Anne de Camerle sa nièce femme dudit Sieur Laurens Carretier pour pouvoir de son dit héritage en jouir après sa mort et s’il arrive que la dite Anne Camerle vienne à mourir sans enfant naturels et légitimes ledit testament luy a substitué et substitué ledit Sieur Blaise Camerle son frère et sy ledit Sieur Blaise Camerle venait a mourir aussy sans enfant …/…
Figure 183. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.
…/… naturel et légitime yceluy a substitué et substitué ledit Sieur Jacques Magnan père, et le cas de la substitution arrivant ledit testateur veut que ledit Sieur Magnan père jouisse pendant sa vie dudit héritage et qu’après sa mort ou plutôt sy bon luy semble ledit héritage vienne et appartienne audit Magnan fils pour qu’il en jouisse à ses plaisirs et volontés. C’est son testament dernier non empatif et son ordonnance de dernière volonté non usurpatrice extrème qui veut valloir par le droit en et par yceluy ne valloir que ce soit par codicil, donation à cause de mort et autrement, en la meilleure forme et manière qu’on chaqu’un de nier, le valable testament doit et peut valloir, cassant et renvoyant toutes autres dispositions qu’il pourrait avoir s’y devant faites, quelles cause dérogatoires qui pourraient y être opposées voullant et entendant que le présent porte son plein et entier effet ayant très bien reconnu les témoins et prie yceux d’être mémoratif de sa présente disposition et (…) requis acte qui a été fait et publiquement écrit dans ledit lieu de St André dans la maison dudit Sieur testateur présents Sieurs Jean François Banon maitre arpenteur Julien de Verfeuil Jean Vairenche tisserand (…) Pierre Delaine bourgeois, Marc Sauze ménager, Estienne Lauron Jacque Odol, Guilhaume Coste ménager tous habitant dudit St André Antoine Lauron tisserand de toille aussy du lieu, et Monseigneur Antoine Donand notaire Royal habitant à Cavillargues requis.
Suivent les noms des signataires les dates et le montant de la prestation du notaire soit : Six Livres douze sols. Sachant qu’une journée de charpentier coûte 0.20 livre le présent testament a coûté au testateur l’équivalent de 30 journées de travail d’un charpentier.
Si on additionne les différentes sommes léguées on trouve un total de 4359 Livres ce qui représente sur notre échelle du charpentier 60 années de travail. On peut aussi le comparer à un salaire d’aujourd’hui, par exemple de 1500 € pour ne pas être trop gourmand, ce qui nous donne 1500 € multiplié par 12 mois multiplié 60 ans = 1 080 000 €.
Il lègue le reste de ses biens : prêt en cours, terres, immeuble à sa sœur Anne épouse Carretier de St Victor La Coste. Pour un petit curé de campagne il avait de beaux moyens !
Le prieur Dominique Camerle était aussi prêteur sur gage.
C’est ainsi, sentant sa fin prochaine, qu’il fait mettre en bonne forme devant notaire ses reconnaissances de dette pour que ses héritiers, notamment sa sœur, puisse en profiter. On a dans les archives ces reconnaissances de dettes. Il prêtait de l’argent par exemple pour acheter un troupeau moitié moitié avec un habitant de la paroisse. Une moitié lui appartenait et l’emprunteur l’élevait avec sa part du troupeau c’était les intérêts et la moitié de l’emprunteur servait de gage au remboursement. Par exemple avec Estienne Lauron il lui prête 86 livres et ils ont en commun au moment de la reconnaissance de dette : 35 moutons, 20 brebis, 15 agneaux, 5 bédigas (agneau d’un an) 4 chèvres, 1 chevreau.
A la même époque il a prêté 189 livres à Pierre Ponsonnet et 271 livres 12 sols à Marc Sauze.
V.XVIII – QUE MANGEAIT-ON EN CES EPOQUES LOINTAINES ?
Voici encore un sujet qui me tient à cœur …
Figure 184. Deux repas.
Boccace. Le Décaméron. Flandres 1432 (BnF, Ms 5070 fol 304)
La nourriture des paysans.
Avec les fromages, les racines et les fruits, le pain était la base de la nourriture paysanne.
Il était fait de farine de blé, de gruau, de seigle. De grosses tranches épaisses, servaient d’assiette ou de supports aux viandes en sauce, on les donnait ensuite aux chiens avec les restes dans les familles les plus aisées.
Les légumes étaient de trois sortes :
– les racines tels que navet, panais, betterave, salsifis, carottes …
– puis les féculents, pois, lentilles, fèves …
– et enfin les légumes verts comme les choux, salades, bettes, cardons. Ce qu’on appelle les fines herbes étaient surtout utilisées en condiment à la place du sel sur lequel pesait un impôt très lourd : la gabelle comme je l’ai expliqué plus haut.
Les fruits, cultivés ou sauvages sont de la région et de saison, pommes prunes, raisins, poires sont cultivés, les fraises, framboises, mûres sont cueillies en forêt.
La châtaigne a aussi joué un grand rôle dans l’alimentation régional. Pendant les périodes de disette les gens partaient à pied en Ardèche pour acheter quelques sacs de châtaignes sèches ou en farine, qui étaient souvent soit véreuses soit charançonnées.
Enfin les glands de chênes ont été consommés. En période de famine ils se sont révélés être une alimentation acceptable pour les hommes, mais la présence de tanins, substance astringente, en quantité appréciable en limite naturellement l’absorption. Lorsque, en cas de nécessité, ils devaient consommer des glands amers, nos ancêtres les faisaient bouillir dans plusieurs eaux après y avoir jeté une poignée de cendres de bois. Quand l’eau était claire, cela signifiait que les glands avaient perdu une bonne partie de leur amertume et étaient sinon délicieux, du moins mangeables. On les apprêtait alors, soit en les faisant rôtir, soit en les faisant sécher et en les réduisant en farine qui était ajoutée à de la soupe ou à diverses autres préparations. Pour certains, il n’y avait rien de meilleur que de la farine de gland ajoutée à du bouillon gras.
Et que buvait-on ?
L’eau est la boisson la plus utilisée. La nature de l’eau est froide donc on pense qu’elle aide à répandre la nourriture dans le corps et refroidit les membres de complexion chaude!
L’eau est puisée dans les puits privés et publics, dans les sources et les rivières, stockée dans les citernes, principalement dans le sud de la France.
Selon Barthélemy l’Anglais, l’eau de pluie est « la meilleure et la plus savoureuse et la plus légère et la plus nette ».
Mais cette eau est souvent polluée par les fosses d’aisances, trouble, saumâtre, souillée par la poussière, les débris végétaux et animaux, voire nocive pour la santé. Les apothicaires conseillent donc de la consommer bouillie, filtrée avec une toison de laine ou mêlée à du vinaigre, du verjus ou du vin aigre, du miel ou de la réglisse.
Pour toutes ces raisons, l’eau est plutôt réservée aux pauvres, aux pèlerins, aux ermites, aux gens du commun.
Dès que l’on en a les moyens on préfère boire de la piquette ou de la cervoise (bière).
Ceux qui voyageaient pour leur commerce ou leurs obligations, emportaient pour manger pendant plusieurs jours du pain rassis, du fromage dur et de la bière.
La nourriture des nobles et des familles aisées.
Contrairement aux idées reçues, les hommes du Moyen Age ne font pas des repas pantagruéliques. Mis à part quelques grands festins, comme il en existe à toutes les époques, leurs menus n’étaient pas plus abondants que les nôtres mais plus variés. Les banquets des 18° et 19° siècles sont bien plus surchargés que ceux de la période médiévale.
Ce qui a induit en erreur des historiens pressés, c’est la forme du repas.
Le repas médiéval pour de nombreux convives, s’entend, se caractérise par une grande liberté de choix, et ressemble en réalité au buffet moderne : plusieurs services se succèdent comportant chacun un ensemble de plats variés, disposés simultanément sur la table. Chaque convive choisit, à chaque service, en fonction de ses goûts et de son rang social (les plus hauts placés dans l’échelle sociale, se servent les premiers), parmi les plats qui sont présentés à proximité.
L’homme médiéval est en effet plus respectueux des goûts de chacun que l’homme moderne, qui impose à chaque convive, dans un repas traditionnel, de manger le même menu que son voisin.
Le classement suivant en services est un exemple de repas somptuaire à l’occasion d’une grande fête. Je n’ai pas détaillé les viandes grillées et leurs sauces, moment fort du banquet, (je ne vais pas vous expliquer comment faire un barbecue).
Le 4e service pourrait correspondre à l’entremets, qui est un intermède de musique et d’acrobaties (souvent placé après les viandes) pendant lequel on servait pâtés en croûte, nourritures déguisées, ou pièces montées, pâtés géants etc…
Donc au menu aujourd’hui nous avons
1e Service
-
-
-
- • Vin blanc au miel et à la sauge.
-
- • Hypocras.
-
-
2e Service
-
-
-
- • Soupe au verjus.
-
- • Soupe au poulet, aux herbes et aux épices.
-
- • Carottes au cumin et à l’huile d’olive.
-
- • Raves ou navets au cumin et à la rue.
-
- • Caviar d’aubergines.
-
- • Pâtes sucrées au parmesan et à la cannelle.
-
- • Omelette aux herbes.
-
- • Saucisses pommes cannelle muscade.
-
- • Salade anglaise.
-
-
3e Service
-
-
-
- • Poulet sauté à la coriandre et au cumin.
-
- • Poulet aux écrevisses.
-
- • Poulet grillé au lait d’amande.
-
- • Poulet au vin et au verjus parfumé à la cannelle et au gingembre.
-
- • Poule au pot à la cannelle et aux amandes.
-
- • Agneau aigre-doux parfumé de cannelle et de gingembre.
-
- • Civet de lapin aux épices.
-
- • Porc aigre-doux au gingembre.
-
- • Diverses viandes grillées et leurs sauces.
-
-
4e Service « Entremets »
-
-
-
- • Galettes de pois chiche.
-
- • Tourtes à l’ail, au fromage, aux raisins et aux épices .
-
- • Tourtes poulet, porc, fromage, herbes, épices.
-
-
5e Service « Desserte »
-
-
-
- • Chausson de pommes, figues, raisins et épices.
-
- • Poires crues ou cuites au sirop parfumées de cannelle et de gingembre.
-
- • Compote de pommes aux amandes.
-
- • Flans, crèmes, tartes.
-
- • Rissoles de pommes, figues, raisins, noix, épices et/ou farce de viande.
-
- • Truffes crues en saison.
-
-
L’yssue de table
-
-
-
- L’yssue de table termine le repas pris à table.
-
-
-
-
-
- Musique et danses peuvent l’accompagner dans certains festins.
-
-
-
-
-
- Elle est composée de pâtisseries cuites entre 2 fers par l’oublieur (garçon patissier), appelées des oublies, mestier, gaufres, supplications, gros bâton.
-
-
-
-
-
- Il s’agit en général de l’équivalent de nos gaufres et gaufrettes ou tuiles roulées, mangées accompagnées d’hypocras (Vin aux épices).
-
-
Le boutehors
-
-
-
- Il se sert après avoir desservi et enlevé la table.
-
-
-
-
-
- Il est composé de vin et d’épices de chambre, c’est à dire des épices ou des fruits confits dans du sucre ou du miel : gingembre, coriandre, fenouil ou anis confits, pignonat (nougat de pignons), codognat (pâte de coing), noisettes ou pistaches confites.
-
-
-
-
-
- Les épices de chambre sont réputées faciliter la digestion : dragées et confitures sont aussi bien des médicaments que des confiseries.
-
-
-
-
-
- Les épices confites sont souvent préparées par les apothicaires et données aux malades.
-
-
Le repas peut commencer.
Une servante apporte d’abord l’aiguière (sorte de broc) et du linge de fine toile pour que les convives se lavent les mains. Puis le service commence.
La fourchette est inutile : on mange avec les doigts, en respectant des règles strictes de savoir-vivre, en particulier interdiction de sucer ses doigts après usage. On s’essuie les mains dans la nappe puisqu’on utilise peu de serviettes.
Autres façon de jouir des nourritures terrestres
Si la cuisine est une pièce spécifique, réservée à la préparation et la cuisson des plats, les enluminures et peintures représentant des repas mettent souvent en scène des convives attablés dans la chambre, à proximité du lit.
Figure 185 La table dans la chambre Barthélémy l’Anglais.
Livre des Propriétés des choses. XVe (BnF, Ms fr 9140 fol 50v)
Ou, plus surprenant encore, dans des pavillons de bains publics « les étuves », à proximité de tonneaux faisant office de baignoire : certains convives mangeant pendant que d’autres se baignent nus, à côté ou étaient au lit pour quelques ébats …!
Figure 186 Repas et bain
Le livre de Valère Maxime. Les étuves. XVe (BnF, Arsenal Ms 5196 fol 372)
Illustration : site Bibliothèque nationale de France
Cette coutume intéressante, disparaît à la fin du 15e siècle : l’église décide d’abord d’interdire la mixité des étuves, puis fait fermer les établissements de bains jugés trop licencieux. Après cela, on ne se lavera plus correctement pendant des siècles, encore un progrès dû à la religion. Il y a toujours eu des « casse-ambiances »
Des goûts de des couleurs …
On remarquera que les goûts culinaires étaient assez proches des goûts actuels qui reviennent aux mélanges sucré salé et aigre-doux.
Le goût du sucré se développe et se détache du salé à partir des 15e et 16e siècles, au fur et à mesure du développement de la culture de la canne à sucre.
La séparation nette entre plats salés en début et milieu de repas et plats sucrés en fin de repas débute à partir du 17e siècle en France.
Elle va de pair avec l’antinomie entre sucré et salé : la tradition classique française refuse l’usage du sucre avec viande, poisson et légumes et l’usage du sel avec fruits, gâteaux et autres desserts. Les autres pays d’Europe ont été plus ou moins influencés par ce refus français du mélange sucré – salé, mais n’abandonnent pas tout à fait ce mélange.
Malgré tous les malheurs qui ont frappé l’Europe depuis le début du 14e siècle, famines, guerre entre Français et Anglais, la Peste Noire, malheurs qui ont anéanti près de la moitié de la population, on constate avec étonnement que le commerce des épices a marché toujours.
Les riches bourgeois et les grands seigneurs, semblent pris d’une frénésie de vivre pour échapper, peut-être, à la peur de mourir.
Quelle époque contrastée et paradoxale que le 14e siècle !
Et pour finir quelques recettes anciennes.
Concernant la cuisine médiévale, voire postmédiévale il existe trois ouvrages célèbres, entre autres qui sont venus jusqu’à nous, ce sont :
Le Viandier
Ce livre de cuisine le plus diffusé à l’époque médiévale, a été attribué à Guillaume Tirel, dit Taillevent. Manuscrit de la Bibliothèque Nationale (Paris) 145 recettes, composé vers 1380 que l’on peut télécharger sur internet.
Le Ménagier de Paris
C’est un livre manuscrit d’économie domestique et culinaire écrit au XIVe siècle. Il est attribué à un bourgeois parisien et fut écrit à l’intention de sa jeune épouse afin de lui faire connaitre la façon de tenir sa maison et de faire la cuisine
Du fait de cuysine. En 1420, Maistre Chiquart le dicte, au clerc Jehan de Dudens à Annecy. C’est en fait le Duc Amédée VIII qui a demandé à Maistre Chiquart de mettre par écrit son art de cuisinier à la gloire de la cour de Savoie.
Voici quelques recettes :
Apéritifs
Recette de l’Hypocras médiéval
Les premiers textes faisant mention d’une recette pour l’Hypocras remontent au XIIIème siècle. Il existe une multitude de recettes, chacun y mettait les épices qui correspondent à son budget où à la facilité qu’il avait à se les procurer. Si le sucre existait et était utilisé parfois, le miel le remplaçait le plus souvent (et à mon avis avantageusement). La recette que je vous propose de l’Hypocras est une variante parmi tant d’autres que j’ai testée et qui est très agréable à boire frais :
-
- Ingrédients :
-
- – 1 bouteille de vin rouge ou blanc (au choix) je préfère avec du blanc
-
- – 80 à 100 g de miel
-
- – ½ cuillère à café de cannelle moulue.
-
- – 30 g de gingembre frais
-
- – 5 clous de girofle
-
- – 10 gousses de cardamome
-
- – Une « branche » d’étoile d’anis étoilé
-
- Recette :
-
-
- Verser le vin et le miel dans un récipient.
-
-
-
- Broyer les épices et les mettre dans une toile nouée (ou filtrer le tout après macération)
-
-
-
- Mettre la toile contenant les épices dans le breuvage et recouvrir.
-
-
-
- Laisser macérer au moins pendant 4 heures 48 heures c’est mieux.
-
-
- Retirer la toile contenant les épices (filtrer avant consommation).
Vin blanc au miel et à la sauge selon Ut vinum salviatum fin 13e siècle.
-
- Ingrédients
-
- – 1 litre de vin blanc
-
- – 130g de miel
-
- – 8 à 11 feuilles de sauge fraîches.
-
- Recette
-
-
- Chauffer une petite partie du vin avec le miel et la sauge finement ciselée. Laisser infuser 10mn à 1/4h (couvert). Mélanger avec le reste de vin et laisser reposer 24h au frais
-
-
-
- Filtrer et conserver au frais.
-
-
- Servir décanté pour avoir le vin clair ou non le vin est alors trouble.
Soupes
Soupe au verjus selon Souppe despourveue (Soupe improvisée), Ménagier de Paris, 1393.
-
- Ingrédients
-
- – 1.5 l bouillon de bouillon de bœuf ou de poule : viande + eau + poireau, carotte, oignon. Un bouillon de poule-au-pot ou pot au feu sera excellent.
-
- – vinaigre (1 cuillère à soupe)
-
- – verjus (3 cuillères à soupe)
-
- – 2 oeufs
-
- – 80 g de chapelure
-
- – 1/10 cfé de gingembre
-
- – 1/10 cfé de muscade
-
- – 1/10 cfé de safran
-
- – 1 pincée de clou de girofle
-
- – 3 g de sel.
-
- Recette (cuisson = 5mn)
-
-
- Faire chauffer le bouillon. Battre les oeufs. Les mélanger au bouillon chaud, hors du feu, en battant au fouet. Ajouter la chapelure, puis les épices délayées dans le verjus et le vinaigre.
-
-
- Cuire quelques minutes en remuant et servir.
Soupe au poulet, aux herbes et aux épices selon Brodio martino, Liber de Coquina (fin 13e siècle).
-
- Ingrédients. Pour 5 personnes
-
- – 240 g de blanc de poulets
-
- – 1,25 l d’eau
-
- – 120 g d’oignon (net épluché)
-
- – 100 g de lard frais
-
- – 70 g de chapelure (pain sec broyé)
-
- – 14 g de persil
-
- – 4 g de menthe (26 feuilles)
-
- – 17 feuilles d’origan
-
- – 10 feuilles de romarin
-
- – 3/4 cfé de gingembre
-
- – 1/2 cfé de cannelle
-
- – 1/4 cfé de noix de muscade
-
- – 1/10 cfé de clou de girofle
-
- – 7 g de gros sel.
-
- Recette (Cuisson = 15 mn)
-
-
- Prendre des blancs de poulet coupés en petits morceaux, les faire revenir avec des oignons et du lard hachés fin. Rajouter eau et sel, les herbes hachées : persil, menthe, origan et romarin. Mélanger. Ajouter de la chapelure (prendre du pain sec broyé, car la chapelure du commerce est souvent déjà aromatisée). Faire cuire 10mn.
-
-
- Rajouter les épices. Terminer la cuisson 5mn. Servir chaud.
Volailles
Hochepot de poullaille: Poulet au vin et au verjus parfumé à la cannelle et au gingembre.
Cuisés vostre poulaille en eaue et vin, ou autre grain, et despeciés par quartiers, et friolés; prennés almendez toutes seiches, et cuisés sans peller, et de canelle grant foison; broiés, coullés, et deffaites de vostre boullon de buef, et boulliés bien aveques vostre grain, et du vergus; et prennés gingembre, girofle, graine de paradis, et soit liant.
-
- Ingrédients
-
- – 1 poulet
-
- – 120 g de foie frais
-
- – 70 g de saindoux ou huile
-
- – 300 g de pain campagne grillé
-
- – 800 g de vin
-
- – 800 g de bouillon de boeuf
-
- – 400 g de verjus
-
- – 3 cfé de cannelle
-
- – 2 cfé de gingembre
-
- – 1/2 cfé de maniguette (poivre de Guinée1 ou encore graine du paradis).
-
- – 5 g de sel.
-
- Recette
-
- Cuisez votre volaille ou toute autre viande dans de l’eau et du vin, coupez-la en morceaux et faites-la revenir; prenez des amandes toutes sèches et cuisez-les sans les peler et de la cannelle en grande quantité. Broyez le tout, passez (à l’étamine) et délayez avec du bouillon de boeuf, et faites bien bouillir avec votre viande et du verjus. Ajoutez gingembre, girofle, graine de paradis. La sauce doit être épaisse.
Poulet aux écrevisses selon Tuille de char, Ménagier de Paris, 1393.
-
- Ingrédients
-
- – 1 poulet (1,5 kg)
-
- – 280 g d’écrevisses (4 ou 5 par personne)
-
- – 30 g saindoux ou huile
-
- – 60 g d’amandes entières
-
- – 50 g de pain de campagne grillé
-
- – vin pour le bouillon
-
- – 250 g de verjus
-
- – 1/2 cfé de cannelle
-
- – 1/2 cfé de gingembre
-
- – 1/4 cfé de poivre long
-
- – 1/4 cfé de clou de girofle
-
- – 3 g de sel.
-
- Recette (cuisson du poulet = 1h)
-
-
- Couper le poulet en morceaux et faire un bouillon avec de l’eau et du vin. Enlever les morceaux de poulet quand ils sont presque cuits, laisser les carcasses cuire pour finir le bouillon.
-
-
-
- Préparation des écrevisses :
-
-
-
- Faire cuire 4 à 5 écrevisses par personne (5mn, juste couvertes d’eau). Enlever et broyer les carapaces et tous les déchets (garder les chairs et l’eau de cuisson).
-
-
-
- Blanchir les amandes entières non pelées, les broyer avec le pain grillé et mélanger avec les carapaces et déchets broyés. Mouiller avec une partie du bouillon et de l’eau de cuisson des écrevisses et passer à l’étamine (2 fois). Ajouter les épices délayées dans un peu de verjus. Ajouter le reste de verjus. Faire bouillir le tout pendant quelques minutes pour que la sauce épaississe.
-
-
-
- Finition du poulet :
-
-
-
- Faire revenir les morceaux de poulet préalablement cuits dans le bouillon. Servir à l’assiette, couvert de sauce, et la chair de 4 ou 5 écrevisses posées en tuiles par-dessus.
-
-
-
- Remarque Le Ménagier de Paris indique de saupoudrer de sucre avant de servir.
-
Agneau
Agneau aigre-doux parfumé de cannelle et de gingembre selon Egurdouce (Aigre-doux), 1390.
-
- Ingrédients
-
- – 2 kg d’agneau
-
- – 120 g lard frais et un peu de saindoux (ou huile)
-
- – 600 g vin rouge
-
- – 140 g vinaigre
-
- – 30 g chapelure
-
- – 60 g amandes non mondées
-
- – 350 g oignons
-
- – 140 g raisins de Corinthe
-
- – 2 cfé cannelle
-
- – 1,5 cfé gingembre
-
- – 1/2 cfé poivre
-
- – 3 g de sel.
-
- Recette (cuisson = 1h20)
-
- Faire sauter la viande en morceaux. Ajouter les raisins et les oignons (blanchis), faire revenir. Déglacer vinaigre. Puis, ajouter vin, épices, amandes broyées et sel. Mijoter (une bonne heure) avec une bonne quantité de graisse blanche. Enfin, ajouter la chapelure délayée dans un peu de bouillon, pour épaissir.
Lapin
Civé de connin (Civet de lapin), Ménagier de Paris, 1393.
-
- Ingrédients (1 cfé = cuillère à café rase)
-
- – 1 lapin (1,4 kg environ)
-
- – 30 g de saindoux ou d’huile
-
- – 70 g de pain de campagne grillé
-
- – 150 g de vin
-
- – 80 g d’un bon vinaigre de vin rouge
-
- – 500 g de bouillon de boeuf ou de poulet
-
- – 60 g de verjus
-
- – 250 g d’oignons
-
- – 2 cfé de gingembre
-
- – 1/2 cfé de cannelle
-
- – 1/4 cfé de noix de muscade
-
- – 1/4 cfé de poivre long
-
- – 1/4 cfé de maniguette
-
- – 1 pincée de clou de girofle moulu
-
- – 2 g de sel.
-
- Recette (cuisson= 1h30)
-
-
- Faire rôtir un lapin au gril ou à la broche, le couper en morceaux. Faire suer les oignons. Faire sauter les morceaux de lapin et les oignons. Déglacer avec le vinaigre et réduire un peu.
-
-
-
- Faire griller le pain, puis le tremper avec le bouillon et le vin. Mixer, ajouter les épices en poudre qu’on a délayées dans une cuillère de verjus, ajouter le reste de verjus. Mélanger au lapin. Faire cuire ensemble pendant 3/4h.
-
-
-
- Le Civé doit être brun, relevé par le vinaigre et modéré en sel et en épices.
-
Tourte
Tourte parmesane Tourte au poulet, au porc, au fromage, aux herbes et aux épices selon, Modus (1380-1390)
-
- Ingrédients
-
- – Pâte brisée pour pâté en croûte
-
- – Par exemple : 1kg de farine + 300g de beurre + 2 oeufs + 14 g de sel + eau.
-
- – 400 g de blanc de poulet
-
- – 400 g de porc
-
- – 500 g de lard frais (ou gorge)
-
- – 100 g de fromage de chèvre sec râpé (éventuellement emmental)
-
- – 3 oeufs
-
- – 1 cfé de gingembre
-
- – 1/4 cfé de poivre
-
- – 1/8 cfé de clou de girofle
-
- – 20 g de persil
-
- – 10 g de menthe
-
- – 10 g de marjolaine fraîche
-
- – 15 g de sel.
-
- Recette (cuisson = 1h)
-
-
- Faire la pâte brisée.
-
-
-
- Hacher fin le porc et le lard. Hacher moyen le poulet ou le couper en petits cubes. Mélanger le lard haché avec les épices, puis avec les herbes, les oeufs, le sel, puis avec le fromage. Ajouter le porc haché et le poulet. Bien mélanger.
-
-
-
- Etaler la pâte (1/2 cm) et foncer les moules à pâté croûte. Ajouter la farce. Tasser un peu et fermer le pâté en croûte. Coller les bords et faire 2 ou 3 cheminées sur le dessus (selon longueur).
-
-
- Cuire environ 1h ainsi : 20mn à four très chaud, 30 ou 40 minutes à four moyen selon taille des moules; laisser encore 5mn à four éteint. Laisser refroidir et démouler. Couper en tranches juste avant de servir.
Desserts
Tartres de pommes, Chausson de pommes, figues, raisins et épices selon, le Viandier de Taillevent, 1380.
-
- Ingrédients
-
-
- – Pâte brisée : 500 g de farine, 1 œuf, 180 g de beurre, 10 g sel et eau.
-
-
- Garniture :
-
- – 1 kg net de pommes acidulées
-
- – 120 g de figues
-
- – 80 g de raisins secs
-
- – 1 oignon
-
- – 1 cuillère à soupe de vin
-
- – 70 g de sucre
-
- – 1/2 cfé de cannelle
-
- – 1/2 cfé de noix de muscade
-
- – 2 pincées de safran
-
- – 1 pointe de cfé de clou de girofle
-
- – 1 pincée de sel.
-
- Recette (cuisson = 3/4 h)
-
-
- Faire la pâte brisée.
-
-
-
- Mélanger les pommes, pelées et coupées en morceaux, avec les figues hachées en petits morceaux et les raisins secs. Ajouter l’oignon émincé frit au beurre ou à l’huile et déglacé au vin. Saupoudrez de sucre mélangé aux épices (safran, cannelle, noix de muscade, clou de girofle pilé).
-
-
- Garnir bien épais le chausson. Dorer avec le safran (trempé dans un peu d’eau). Cuisson 3/4h à four bien chaud.
Poires, au sirop, parfumées de cannelle et de gingembre selon Wardonys in syryp (Poires au sirop), Harleian (15e siècle).
-
- Ingrédients
-
- – 1 kg net de poires à cuire
-
- – 600 g de vin rouge
-
- – 200 g de sucre
-
- – 1 cfé de vinaigre
-
- – 2 cfé de cannelle
-
- – 1/2 cfé de gingembre
-
- – 1/8 cfé de clou de girofle
-
- – une pincée de safran.
-
- Recette (cuisson = 30mn)
-
- Mélanger le vin et la cannelle, laisser reposer (1/2h) et passer plusieurs fois à l’étamine. Faire chauffer le vin avec le sucre, jusqu’à consistance d’un sirop. Eplucher les poires, les couper en quartiers puis les pocher (30mn) dans ce « sirop » frémissant (si poires de type Williams pocher 10mn). Ajouter gingembre, safran et clou de girofle (éventuellement le vinaigre) et laisser refroidir les poires dans leur « sirop ».
Ung emplumeus de pomes(Une bouillie sucrée de pommes), selon Maître Chiquart, Du fait de cuisine, 1420.
-
- Ingrédients
-
- – 800 g net de pommes (1 kg brut)
-
- – 150 g d’amandes en poudre
-
- – 100 g de sucre
-
- – 250 g d’eau
-
- – sel.
-
- Recette
-
-
- Choisir des pommes à cuire acidulées, les éplucher et les couper en morceaux.
-
-
-
- Faire bouillir l’eau, ajouter les pommes et les faire cuire à couvert (10mn ou plus selon variété). Puis, égoutter les pommes en conservant l’eau de cuisson.
-
-
-
- Monder (enlever la peau) et broyer de bonnes amandes douces, ou tout simplement utiliser de la poudre d’amande. Délayer les amandes avec l’eau de cuisson des pommes pour faire un lait d’amande bien épais. Laisser reposer 1h et filtrer le lait d’amande à l’étamine (bien presser la pulpe d’amande).
-
-
-
- Puis, faire bouillir le lait d’amande avec une pincée de sel et ajouter les pommes finement hachées et le sucre. Servir froid.
-
-
-
- Remarque
-
-
- La recette historique précise grant foison de sucre (beaucoup) et (grant quantité) d’amande
.
V. XIX – CONCLUSION.
Après ce long voyage, commencé il y a 130 millions d’années, nos derniers siècles d’histoire nous semblent bien dérisoires. Que sont ces conflits et cette organisation humaine en comparaison des bouleversements géologiques, des cataclysmes terrestres des disparitions d’espèces qui ont modelé notre espace de vie actuelle ?
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire et raconter sur ce tout petit espace de mille hectares perdu dans l’univers. L’ambition de la jeunesse actuelle et de la majorité des gens est de voyager de par le monde pour découvrir des choses et des lieux qu’ils imaginent mieux et plus beaux que là où il vivent, alors qu’ils ignorent tout, ne voient pas et ne connaissent rien de la région où ils sont. C’est dans le but de faire connaitre tout ce que j’avais vu et appris sur cette petite portion de terre que je me suis attaqué à la réalisation de cet ouvrage.

Figure 158. Numérisation de l’Auteur. Collection personnelle.
Le Potier.
L’idée de façonner la terre ne date pas d’hier et le potier, « homme de la terre » s’il en est, reste l’un des plus vieux artisans de notre civilisation.
Utilisées depuis toujours pour la cuisson des aliments ou au service de l’eau, les poteries deviennent alors objets de décoration ou même d’art. Le potier est doublement homme de la terre : il la façonne et il la cultive. Sauf pour les plus grands centres, il est aussi un cultivateur qui retourne à son champ et à sa vigne si son activité d’artisan n’est plus suffisamment rentable. Inversement, des paysans deviennent artisans par leur mariage avec la fille d’un potier, bien que les alliances se fassent en général entre familles de la même corporation.
La situation sociale du potier est très variable selon sa place dans la hiérarchie du métier, la région et l’importance des ateliers. Au XVIIIème siècle, des maîtres potiers-laboureurs propriétaires de leurs ateliers sont des gens aisés, qui savent lire, écrire et compter. En revanche, les maîtres potiers-métayers qui doivent céder à leur propriétaire la moitié de leur production sont souvent aussi pauvres que des ouvriers.
Le tourneur est le plus qualifié, le plus apprécié et le mieux payé des ouvriers. Le tournage est l’apanage des hommes. Les femmes et les filles des potiers sont cantonnées dans des besognes annexes et mal rétribuées, telles la pose des anses et les finitions. Il est propriétaire de son tour et travaille avec un manœuvre et une finisseuse qu’il paye sur son salaire. Il est rémunéré à la pièce, au compte (un ensemble de pots) ou à la journée.

Figure 159. Numérisation de l’Auteur. Collection personnelle.
Chapelier.
Un chapelier fabrique des chapeaux, non pas à la chaîne, mais selon des méthodes artisanales. La conception d’un chapeau passe par plusieurs étapes et peut nécessiter des dizaines d’heures de travail, pour les chapeaux les plus complexes.
Tout d’abord, il y a la phase de création où l’imagination a une place importante pour créer un produit qui pourra satisfaire les besoins d’un client ou d’une élégante.
La seconde étape consiste à mouler les chapeaux sur des supports en bois sur lesquels on applique les feutres et les pailles pour donner une forme à la matière.
La dernière étape, quant à elle, repose sur la finition où l’on peut appliquer des tissus, des voilettes ou même des fleurs pour garnir le chapeau. Le chapelier peut également travailler avec des fleuristes pour parfaire sa création.
Moulinier
Autrefois on plongeait les cocons dans l’eau chaude pour dévider le fil de soie.
Le fil passait ensuite à la dévideuse pour dérouler le cocon afin d’en tirer le fil de soie et la dévideuse réunissait plusieurs fils, de quatre à dix selon la grosseur du fil désirée. Le moulinier intervient à ce stade en permettant de rendre le fil de soie utilisable pour le tissage.
Le moulinage consiste à tordre ensemble plusieurs fils de soie pour plus de solidité. Plus le fil est tordu, plus l’étoffe sera souple.
Ensuite, on faisait bouillir les écheveaux avec un dissolvant afin d’éliminer les dernières traces de grès, matière qui entoure le fil de soie.
Le fil est ensuite imprégné d’alun afin de pouvoir recevoir la teinture avant d’être tissé sur les métiers à bras. Le marchand moulinier faisait commerce des écheveaux de soie qu’il avait patiemment tordus.
Nous avons vu au chapitre précédant qu’en 1842, Hector RIVOIRE identifiait 4 filatures de soie à St André d’Olérargues.
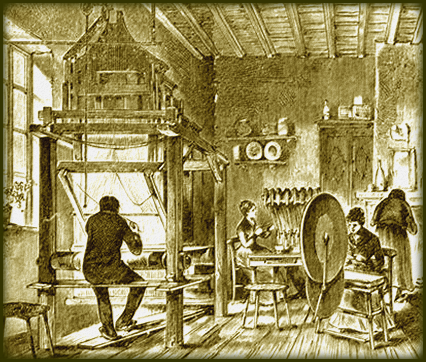
Figure 160. Numérisation de l’Auteur. Collection personnelle.
Quelques autres métiers
Il y avait aussi un tas de métier qui certains se faisaient à plein temps ou en complément du travail de la terre comme les Bouscatiers qui coupaient puis brûlaient le bois pour livrer les villes en charbon de bois, les chaufourniers qui construisaient des fours à chaux dans lesquels ils brûlaient le calcaire, les ruscaïres (écorceurs) qui prélevaient plusieurs types d’écorces à destination des tanneurs pour traiter les peaux etc.